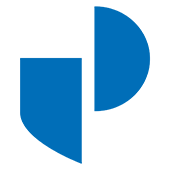Le pronostic vital d’un cancer est très variable en fonction de sa localisation, de son type, de son développement au moment du diagnostic.
Globalement, si la guérison survient dans 1 cas sur 2, une pathologie cancéreuse reste grave, mais aussi fréquente, touchant ainsi 1 sujet masculin sur 2, tous âges et toutes localisations confondues.
La probabilité de décès par cancer est donc de 25 % pour les hommes, ce que confirment les statistiques nationales de cause de mortalité.
Si les conditions de travail augmentent le risque d’apparition d’un cancer du fait de la présence d’un produit cancérogène ou de radiations ionisantes, le médecin doit-il accepter de participer à la gestion de ce risque ? Au plan réglementaire, la question est tranchée : le médecin du travail doit effectuer cette surveillance.
Sur les autres rôles et les moyens du médecin du travail, les Editions Tissot vous conseillent leur publication « Schémas commentés en Santé Sécurité au travail ».
Au plan éthique, chacun se déterminera.
Quelques arguments peuvent faire penser que cette surveillance est au moins « raisonnable ». L’origine du cancer est multifactorielle, les cancérogènes sont souvent présents dans l’environnement naturel, la relation effet-dose est démontrée, la réduction des doses réduit donc le risque, les moyens de protection progressent, les produits sont mieux encadrés (programme REACH), voire interdits (amiante).
L’augmentation du risque est calculable : 4 à 8 % des cancers seraient attribuables au travail. Elle est plus difficilement mesurable et observable sur une population de travailleurs.
Il n’en demeure pas moins que la règle de prévention doit être que, s’il n’y a pas d’éviction totale du danger, le niveau d’exposition doit être le plus faible possible.
Utile ?
La surveillance médicale proprement dite a pour objectif de faire un diagnostic précoce de la maladie avant que les premiers signes conduisent le malade vers son médecin traitant.
Disposons-nous des moyens diagnostiques et thérapeutiques qui permettront de réduire la mortalité, ou au moins d’améliorer le confort de vie des malades ?
Cette question se pose pendant la carrière professionnelle mais aussi pour la surveillance post-professionnelle.
Evidemment, le médecin du travail a un rôle plus large : information des salariés, recherche éventuelle d’autres facteurs de risque, participation aux actions de prévention des risques en milieu de travail, traçabilité des données professionnelles et médicales.
D’où l’importance, entre autres, des différentes visites médicales à des intervalles réguliers ou à l’occasion de certains événements particuliers :
Tableau récapitulatif des différentes visites médicales (pdf | 3 p. | 72,6 Ko)
Les conditions d’un dépistage efficace
La notion de dépistage s’entend ici comme la mise en œuvre de tests qui permettront un diagnostic à un stade précoce, donc préclinique. Ce seront pour l’essentiel des tests biologiques sanguins, urinaires ou cytologiques, des tests radiographiques ou échographiques.
Ils doivent être sensibles et spécifiques, c'est-à-dire évitant les erreurs de diagnostic par excès ou par défaut. Les erreurs par excès conduisent à multiplier d’autres examens plus angoissants et pénibles pour le supposé malade qui finalement, au bout des investigations, se révèle être en bonne santé.
Les erreurs par défaut font manquer le diagnostic d’une maladie qui se déclarera des mois ou des années plus tard à un stade plus avancé et donc potentiellement plus grave.
Les tests doivent aussi être accessibles, rapides, acceptables pour les salariés qui y seront soumis, non dangereux, peu coûteux.
Quels examens, pour quels risques ?
En santé publique, les tests de dépistage qui répondent aux critères évoqués plus haut sont rares. Le consensus s’est fait pour le dépistage du cancer du sein par la mammographie et le dépistage du cancer du côlon par la recherche de sang dans les selles. Le dosage de l’antigène prostatique spécifique (PSA) pour le cancer de la prostate est largement utilisé, mais ne fait pas l’unanimité.
En matière de risque professionnel, le panel n’est guère plus étendu. Les recommandations de l’arrêté du 28 février 1995 pour la surveillance post-professionnelle sont obsolètes.
La Haute Autorité de Santé et la Société Française de Médecine du Travail ont proposé en 2010 et 2011des recommandations de bonnes pratiques :
- suivi post-professionnel des expositions à l’amiante avec mise en avant de l’examen tomodensitométrique thoracique (scanner) ;
- suivi des expositions aux poussières de bois avec examen ORL par naso-fibroscopie pour les expositions il y a plus de 30 ans ;
- à paraître : surveillance après exposition à des cancérogènes pour la vessie.
Intérêt médical ou intérêt social ?
Dans l’état actuel des possibilités thérapeutiques, la pratique périodique d’examens tomodensitométriques thoraciques n’améliore pas globalement, sur l’ensemble de la population suivie, le pronostic des cancers broncho-pulmonaires et des mésothéliomes.
Le cancer de la vessie diagnostiqué précocement peut être guéri ou maîtrisé. Le cancer naso-sinusien est également accessible à la thérapeutique.
L’intérêt social, lui, est certain dans tous les cas. Le diagnostic précoce permettra la prise en charge des soins au titre de l’assurance accident du travail – maladie professionnelle et une indemnisation par une rente, complétée le cas échéant par l’intervention du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
En conclusion, on ne peut que répéter ce lieu commun : la suppression ou la limitation autant qu’il est possible des expositions est plus efficace que le diagnostic précoce des maladies.
Auteur : Christian GUENZI, médecin du travail
Source : "Risque cancérogène et surveillance médicale" (09/11/2011) _ Editions Tissot