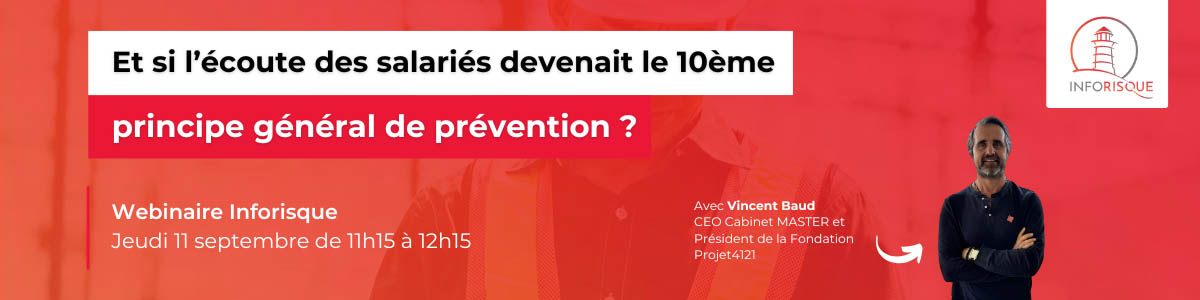"Il faudrait finalement arriver à une évaluation personnalisée de la pénibilité", plaide Sébastien Hulo, médecin du travail au CHRU de Lille.
L'évaluation des capacités cardio-respiratoires est l'un des thèmes développés tout au long du congrès Santé-travail qui se déroule cette semaine à Lille ; il fera l'objet demain de plusieurs conférences et rencontres qui s'interrogeront, entre autres, sur le lien entre la mesure de la capacité cardiaque et respiratoire et la pénibilité. Nous faisons le point avec plusieurs des intervenants sur cette thématique.
Lorsqu'il est question de pénibilité, on pense rythme de travail important ou contraintes physiques. "Mais ces caractéristiques ne prennent pas toujours en compte les vulnérabilités d'un individu", regrette le Dr Sébastien Hulo, médecin du service "explorations fonctionnelles respiratoires" du CHRU de Lille – il est par ailleurs l'un des coordinateurs du congrès Santé-travail Lille 2014. "Pourtant, une personne qui souffre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive, une BPCO, ne rencontrera évidemment pas les mêmes difficultés au travail qu'une personne non malade. Il est désormais nécessaire de bien intégrer les capacités individuelles à la notion de pénibilité. Il faudrait finalement arriver à une évaluation personnalisée de la pénibilité", développe-t-il Pour cela, les médecins du travail doivent disposer de données précises afin de pouvoir réaliser des évaluations homogènes et cohérentes.
Oxygène et tâche professionnelle
Concernant les capacités cardio-respiratoires, l'évaluation passe par l'examen clinique, première étape qui permet de détecter des troubles comme la dyspnée ou les douleurs thoraciques par exemple, mais aussi par l'exploration à l'effort. "Nous devons développer ce type d'explorations", explique Sébastien Hulo : "les explorations réalisées au repos peuvent difficilement prédire les troubles qui pourraient survenir à l'effort et un test d'effort peut révéler certaines pathologies. De plus, nous pouvons savoir jusqu'où une personne peut aller". L'épreuve d'effort donne notamment la consommation d'oxygène maximale, qu'il est possible de relier à une tâche professionnelle précise.
Mesurer le cœur au travail
Certaines activités professionnelles sont listées, avec l'équivalent "équivalent métabolique" nécessaire à leur réalisation. Il s'agit du MET (Metabolic Equivalent of the Task). Par exemple : un travail de bureau nécessite 1,5 MET et l'utilisation d'un marteau-piqueur nécessite 6,3 MET. En plus de cette première évaluation, une cardiofréquencemétrie peut-être proposée. Cet examen permet de suivre la fréquence cardiaque d'une personne durant son poste puis d'estimer, pour chaque tâche effectuée, les besoins en énergie du salarié pour la réalisation de ces différentes tâches. "Les informations fournies par les deux examens sont complémentaires", souligne le Dr Sébastien Hulo.
Évaluation de la pénibilité grâce à la cardiofréquencemétrie

Stéphane Le Boisselier, médecin du travail à l'AST 67, a estimé, à la demande de deux entreprises, la pénibilité de certains postes en fonction de la température extérieure. Il l'a fait à partir d'un test de cardiofréquencemétrie, qui a permis de montrer l'effet de la température. Suite à ces résultats, des recommandations sur l'organisation du travail en saison chaude ont été faites. Et une surveillance médicale a été mise en place pour les personnes ayant des facteurs de risques cardiovasculaires.
Grilles concordantes
Concrètement, pour la réalisation de la cardiofréquencemétrie, la personne est équipée puis suivie par un médecin ou un infirmier, qui note tous ses faits et gestes pendant la durée du test. Les différentes données obtenues sont ensuite analysées à partir de différentes grilles (Chamoux, Frimat ou Meunier), qui permettent de qualifier la pénibilité de "très légère" à "trop intense". "La difficulté que nous rencontrons dans l'analyse des données est justement que trois grilles existent", regrette Stéphane Le Boisselier, qui tempère en ajoutant que dans son étude, "les trois grilles se sont révélées concordantes".
Lien entre pénibilité et fréquence cardiaque
L'arrêté du 15 juin 1993, "déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges", établit clairement le lien entre pénibilité et fréquence cardiaque et recommande de mesurer cette dernière. Mais ce texte a été abrogé en 2012. "Nous attendons un nouveau texte. Dans tous les cas, dès que la pénibilité est démontrée, des recommandations d'aménagement de poste doivent être proposées, des temps de pause plus importants doivent être instaurés. Et le salarié a des droits qu'il doit faire valoir", conclut le médecin du travail.
Pénibilité et maladie cardiovasculaire
Inversement, existe-il un lien entre la pénibilité et l'apparition d'une maladie cardiovasculaire ? Stamatis Klonaris, médecin du Travail à l'Astav (association de santé au travail de l'arrondissement de Valenciennes), a souhaité répondre à cette question en réalisant auprès de 1 800 personnes une enquête de terrain. "Notre étude n'a démontré aucun lien ; elle n'a pas suggéré d'associations statistiques entre les facteurs de pénibilité professionnelle testés, comme le bruit, la manutention, le travail posté ou encore les facteurs de risque psychosociaux élevés, et les maladies cardiovasculaires", décrit le médecin du travail. Mais il insiste sur la nécessité de "rester prudent dans l'analyse de ces résultats statistiques" : "un lien aurait peut-être été trouvé si l'étude avait duré dans le temps. Instinctivement, on se dit que la pénibilité risque d'engendrer un coût cardiaque."
Auteur : Par Clémence Lamirand, actuEL-HSE.
Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.