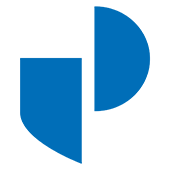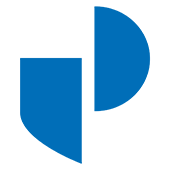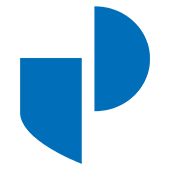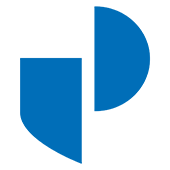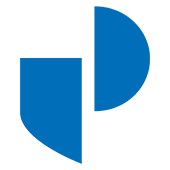Dans une filière aéronautique, espace et défense à la fois interdépendante et sous forte pression de production, la santé au travail est plus que jamais un enjeu stratégique. Les derniers enseignements d’IPECA révèlent une réalité contrastée : le secteur fait globalement mieux que le marché, mais la dynamique d’absentéisme reste en hausse et dépasse toujours le niveau de 2019. Avec 35,8 % de salariés en arrêt au moins une fois dans l’année, une fréquence de 1,7 et une durée moyenne de 20,3 jours (soit 7,5 jours par salarié), la stabilité apparente masque des fragilités opérationnelles bien réelles.
Dans une filière aéronautique, espace et défense à la fois interdépendante et sous forte pression de production, la santé au travail est plus que jamais un enjeu stratégique. Les derniers enseignements d’IPECA révèlent une réalité contrastée : le secteur fait globalement mieux que le marché, mais la dynamique d’absentéisme reste en hausse et dépasse toujours le niveau de 2019. Avec 35,8 % de salariés en arrêt au moins une fois dans l’année, une fréquence de 1,7 et une durée moyenne de 20,3 jours (soit 7,5 jours par salarié), la stabilité apparente masque des fragilités opérationnelles bien réelles.
Le cœur du problème ? Les arrêts courts, nombreux et imprévisibles : 1 sur 2 dure moins de 4 jours et 8 sur 10 moins de 15 jours. Leur effet domino se ressent immédiatement sur les lignes de production et l’organisation des équipes. À l’inverse, les arrêts longs (3 % des arrêts) sont rares et plus prévisibles, bien qu’ils durent en moyenne 117 jours et appellent des remplacements complexes.
Autre signal à ne pas ignorer : de fortes disparités entre structures. En résumé, tout le monde ne joue pas dans la même cour : 17,32 % des entreprises sont en deçà des moyennes (pourcentage et durée), 39,11 % sont proches, 29,05 % au-delà. Plus subtil encore, 14,53 % cumulent un faible pourcentage d’arrêts mais une durée supérieure à la moyenne, signe d’organisations qui « encaissent » mal les cas lourds. Dans une filière interdépendante, ces écarts fragilisent les chaînes critiques.
Le facteur humain pèse lourd. Les ouvriers sont les plus touchés (58 % ont connu un arrêt), loin devant les cadres (26,9 %). Le volume d’absence par salarié culmine à 14,5 jours chez les ouvriers (contre 7,5 jours en moyenne), quand les cadres sont à 4,8 jours. Les 30-40 ans demeurent la tranche d’âge la plus impactée. Côté motifs, trois familles dominent : maladies saisonnières (pics en janvier, février, septembre, octobre), troubles psychiques (1 arrêt long sur 4) et TMS, toujours persistants.

La bonne nouvelle ? La prévention paie. Les accidents du travail ont été divisés par deux depuis 2019 et l’essor des temps partiels thérapeutiques traduit un meilleur accompagnement du retour à l’emploi. Reste un angle mort : les accidents de trajet, qui ne faiblissent pas.
Que faire dès maintenant ? Transformer la prévention en levier mesurable, piloté et partagé. Deux priorités se dégagent : remettre le DUERP au centre du jeu comme boussole décisionnelle, et déployer des actions ciblées sur l’épidémiologie du quotidien, la santé mentale et les TMS (formation managériale, référents dédiés, présence de professionnels de santé sur site).
- Outiller le pilotage : un DUERP vivant, assorti d’objectifs et d’indicateurs (fréquence, durée, récurrence, saisonnalité).
- Agir sur les arrêts courts : campagnes « santé publique », rappels de bonnes pratiques et organisation des remplacements éclair.
- Réduire les risques psycho-sociaux : former les managers, mettre en place des parcours d’alerte et d’orientation rapides.
- Combattre les TMS : ergonomie poste, micro-pauses, kinésithérapie/gestes et postures, suivi des métiers les plus exposés.
- Sécuriser les trajets : plan mobilité, sensibilisation, horaires aménagés, solutions de covoiturage.
- Partager les bonnes pratiques : mutualiser au niveau filière pour lisser les disparités entre structures.
La SQVCT n’est pas un « nice to have » mais un accélérateur de performance industrielle. Faire de la prévention un réflexe collectif, c’est protéger les équipes, et sécuriser les délais, la qualité et la compétitivité. Pour aller plus loin, découvrez les enseignements complets de l’étude IPECA : lire l’analyse et lancez votre plan d’action.
Auteur : Inforisque.