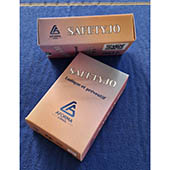Le concept de défense en profondeur est la clé de voûte de la politique de sûreté des installations nucléaires en France et dans le monde depuis les années 1960. Elle repose sur une idée simple : aucune barrière n’est infaillible, mais un ensemble de barrières complémentaires peut empêcher qu’une erreur ou un aléa ne se transforme en accident.
Le concept de défense en profondeur est la clé de voûte de la politique de sûreté des installations nucléaires en France et dans le monde depuis les années 1960. Elle repose sur une idée simple : aucune barrière n’est infaillible, mais un ensemble de barrières complémentaires peut empêcher qu’une erreur ou un aléa ne se transforme en accident.
Par exemple un système permettant de suppléer une coupure d’électricité se traduira par plusieurs sources de secours, de technologies différentes et séparées géographiquement.
Les bons résultats du nucléaire en matière de sûreté et de sécurité ont intéressé les autres secteurs d’activités. Depuis la fin des années 90, le monde industriel a amorcé une réflexion sur l'apport de la sûreté nucléaire à la sécurité industrielle pour la formalisation d'une nouvelle politique de prévention des risques en France. Cette démarche s’est accélérée après l’accident d’AZF en 2001 et la création de l’ICSI, en abordant notamment la transposition du concept de défense en profondeur.
L’ouvrage « La défense en profondeur : contribution de la sûreté nucléaire à la sécurité industrielle » (Franck Guarnieri, Emmanuel Garbolino) aux éditions Tec & Doc explore les aspects théoriques, l’application dans le nucléaire, et la transposition possible vers d’autres secteurs d’activités.
Trois barrières pour un même objectif : éviter l’accident
La première barrière, c’est la prévention : tout ce qui vise à supprimer ou réduire la probabilité d’un événement indésirable (formation, procédures, organisation du travail, équipements adaptés…). Cette barrière est une priorité.
Vient ensuite la récupération, qui permet de détecter rapidement une dérive et de corriger avant qu’elle ne dégénère. Il agit en compensation de la première barrière.
Enfin, l’atténuation limite les conséquences lorsqu’un incident survient malgré tout — grâce à aux équipements, à la communication et à la gestion de crise. Cette barrière va agir sur la gravité de l’accident.
Ces trois niveaux sont nécessaires et forment un système vivant : si l’un s’affaiblit, les deux autres doivent compenser.
Analyser ses barrières pour progresser
Il est intéressant de faire recenser à des référents HSE les actions mises en place dans l’entreprise et de les répartir sur les 3 barrières. Dans la majorité des cas, les efforts se concentrent sur une, voire deux barrières — la prévention et l’atténuation — en oubliant que la récupération est tout aussi essentielle.
Se poser les bonnes questions devient alors crucial :
- Mes barrières existent-elles réellement ?
- Sont-elles équilibrées et fonctionnelles ?
- Un événement perturbateur pourrait-il les franchir ?
Identifier ces points faibles seul ou à plusieurs, c’est déjà renforcer sa culture sécurité.
Un regard extérieur pour combler les lacunes
Pour de nombreuses entreprises, cet exercice d’analyse reste complexe.
Chez AFORMA CONSEIL, nous accompagnons vos équipes dans cette démarche à travers des diagnostics culture sécurité qui observent vos pratiques, analysent vos barrières et proposent des parades concrètes. Nos ateliers ludiques personnalisés inspirés de l’expérience dans le nucléaire de notre formateur, mettent en lumière le principe de défense en profondeur pour faire émerger de nouvelles solutions en faveur de la sécurité au travail.
Parce qu’entre l’erreur et l’accident, il existe toujours des marges de manœuvre — à condition de savoir quelles parades utiliser et quand les placer.
Auteur : Eric Marin, AFORMA CONSEIL.