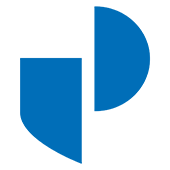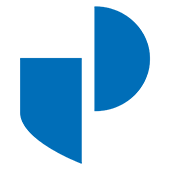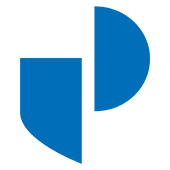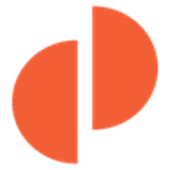Les liens entre le travail, les expositions psychosociales et les troubles psychiques sont régulièrement évoqués depuis une dizaine d’années. L’exposition conjointe à une forte demande et une faible latitude décisionnelle génère un risque significatif moyen de 1,8 de troubles psychiques. Même si des études restent à mener en ce domaine, il est maintenant établi qu’il existe un lien de cause à effet entre des expositions professionnelles psychosociales et une altération de la santé mentale.
L’étude Samotrace
Ce programme développé par l’InVS a pour objectif principal de décrire les troubles de santé mentale selon l’emploi en population salariée. Il comporte trois volets dont le principal est le volet épidémiologique en entreprise (objet de la communication). L’échantillon est globalement représentatif de la population source.
Mal-être : La prévalence du mal-être est de 24 % chez les hommes et 37 % chez les femmes, les catégories des employés et des professions intermédiaires étant les plus touchées. Les secteurs de la finance, de l’administration publique, de la production et distribution d’électricité gaz et d’eau sont les plus touchés.
Alcool : Les problèmes d’alcool sont essentiellement masculins (10,4 % d’hommes versus 2,3 % des femmes).
La tension au travail concerne 35 % des hommes et 41 % des femmes.
Le programme de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP)
Ce programme repose sur un réseau de médecins du travail volontaires animé dans chaque région par la Direction régionale du travail et de la formation professionnelle (DRTEFP) et l’InVS.
Maladies à caractère professionnel (MCP) : la prévalence moyenne des MCP s’élève à 5,8 %.
Souffrance psychique : 1,6% des salariés sont touchés, plus particulièrement les femmes (2,3%)
Là encore, les secteurs les plus concernés sont la finance, l’administration, la construction (pour les femmes).
Les catégories socioprofessionnelles les plus touchées sont les cadres (femmes : 3,6 % - hommes : 1,7 %), les professions intermédiaires (femmes : 2,7 % - hommes : 1,8 %).
Le modèle Karazek
nous apporte une estimation des taux de la population active française touchés par le « job strain », pour 3 grandes pathologies, la santé mentale comme la dépression ou l’anxiété, les maladies cardio-vasculaires (MCV) et les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Qu’est-ce que le « job strain » ? Le job strain se caractérise par un manque de soutien et des marges de manoeuvre limitées, ainsi que des objectifs quantitatifs difficilement atteignables.
Parmi les mauvais comportements, on retrouve par exemple le déni de reconnaissance, les critiques injustes, le mépris ou les propos désobligeants.
La prévalence d’exposition à ces 3 pathologies a été estimée en utilisant les données de l’enquête Sumer (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels) lire (1).
La prévalence d’exposition au job strain est estimée à 19,6 % pour les hommes et 28,2 % pour les femmes.
Santé mentale : Pour les hommes, entre 13,6 et 31,1 % des cas de problèmes de santé mentale sont attribuables au job strain et entre 10,6 et 23,7 % pour les femmes.
MCV : Pour les hommes, entre 3,8 et 20,5 % des cas de MCV étaient attribuables au job strain, et entre 6,1 et 12,6 % pour les femmes. Entre 8 et 22,1 % des décès par MCV étaient attribuables au job strain.
TMS : Les estimations pour les TMS sont comprises entre 12,2 et 26,8 % pour les fractions attribuables au job strain.
Les tentatives de suicide (TS)
Et la mortalité prématurée par suicide selon l’emploi en France. Quel que soit le sexe, les agriculteurs sont les moins touchés par les TS (0,4 % des hommes, 4,1 % des femmes) mais les plus concernés par les décès par suicide. Les ouvriers (3,9 % des hommes,
12,5 % des femmes) sont les plus concernés par les TS.
L’ensemble des résultats consultables (voir lien ci-dessous) traduisent l’urgence d’intervenir sur l’environnement psychosocial et sur les pratiques de gestion des ressources humaines pour diminuer les contraintes dans un objectif de prévention des problèmes de santé mentale.
Auteur : Maurice Chevrier, santé log
Sur le site de l’InVS : Télécharger l'intégralité des résumés au format Acrobat
En savoir plus sur la Santé au travail avec l’INRS
En savoir plus sur le stress au travail avec l’OMS
Lire aussi : (1) SANTE AU TRAVAIL ET RISQUES DE CANCER : L'étude SUMER