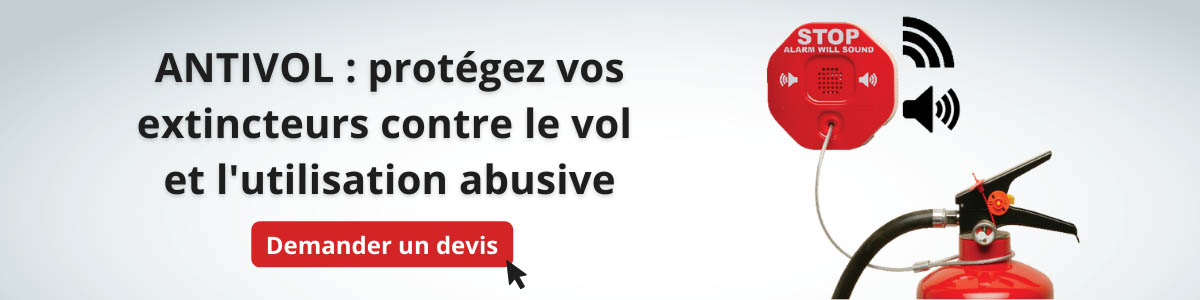Le management intégré des risques professionnels et environnementaux constitue une démarche qui se développe au sein des entreprises, favorisée en cela par les orientations du législateur. La convergence dans la gestion de ces risques reste néanmoins encore partielle, avec des distinctions importantes quant à la finalité des analyses réalisées, aux modalités de participation du public ou des salariés.
Mais, c’est surtout la survenance d’un accident industriel qui témoigne de la différence fondamentale dans la gestion de ces risques. La victime salariée est une victime « super » privilégiée au regard de la victime extérieure à l’entreprise, confrontée aux arcanes de la responsabilité civile.
Dans le cadre des préoccupations liées à la santé des travailleurs, la question du risque écologique, entendu comme le risque sanitaire industriel (Jans, 2007a), devient partie intégrante de la gestion générale des entreprises. Ces questions ne sont toutefois pas abordées de manière homogène : au droit du travail revient la protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, au droit de l’environnement revient la protection de la santé et la sécurité de riverains à l’extérieur de l’entreprise (Jans, 2007b).
Les deux approches ne sont toutefois pas antinomiques. Comme l’avait relevé le ministère de l’emploi en France, après l’accident d’AZF : « il s’agit d’éviter absolument d’opposer sécurité des travailleurs et sécurité des populations, les travailleurs devant être placés au coeur de la réflexion sur la sécurité car ils sont les premiers touchés par les accidents ». Si l’on peut noter une certaine convergence des deux disciplines vers des principes communs, il faut distinguer selon que l’on se situe en amont du risque, avec des dispositions très similaires relatives à l’évaluation et la gestion des risques ou en aval du risque, avec une appréciation des responsabilités et des modalités de réparation bien différentes.
En amont, la volonté croissante de maîtriser les activités humaines et les comportements susceptibles de générer des risques pour la santé humaine et pour l’environnement a amené les pouvoirs publics à multiplier les procédures de contrôle préalables à l’utilisation de certaines substances ou à l’exercice de certaines activités, tant en droit du travail qu’en droit de l’environnement, néanmoins sans réflexion vers une procédure unique. Souvent issues du droit communautaire, ces procédures ont été accueillies dans notre droit interne.
En aval, force est de constater que la question de la sécurité des travailleurs et de celle des personnes extérieures à l’entreprise reçoit un traitement différent de la part des magistrats, lorsqu’il s’agit d’examiner la responsabilité de l’industriel. Si la jurisprudence se montre très sévère envers l’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat et parallèlement très favorable aux victimes salariées en simplifiant la charge de la preuve de la faute inexcusable, il n’en va pas de même pour les victimes d’un accident industriel, de surcroît confrontées à la multiplicité des régimes de responsabilité. Le projet de réforme du droit des obligations issu du rapport Catala (2005)2 prévoyait l’instauration d’une responsabilité automatique, sans faute envers l’exploitant d’une activité anormalement dangereuse, même licite. Mais, ce projet est resté lettre morte jusqu’à présent. La décision du Tribunal correctionnel relative à l’accident d’AZF n’a fait que conforter le constat d’une divergence de traitement juridique des dommages entre salariés et victimes extérieures à une entreprise.
Consulter l'étude Convergences et divergences du traitement juridique des risques professionnels et des risques industriels (Colloque international UMR 5600 - ENTPE, Lyon : France (2010))
Auteurs : Valérie Sanseverino-Godfrin (Centre de recherche sur les Risques et les Crises (CRC)),
et Pascale Steichen (Université Nice Sophia Antipolis (UNS))
dans HAL - Archives Ouvertes.