Le 5 décembre 2016, en rendant sa décision concernant le dépistage salivaire, le Conseil d’État a jeté un pavé dans la mare. L’affaire concernait une entreprise de BTP qui avait introduit les tests salivaires dans son règlement intérieur. Il s'agissait pour elle de contrôler que les salariés occupant des postes dits hypersensibles ne sont pas sous l’emprise de drogues. Réalisés de manière aléatoire, les tests utilisés dépistent six substances. L’inspection du travail rend un avis défavorable motivé par le fait que le règlement intérieur prévoit qu’un supérieur hiérarchique, et non un médecin, pratique les tests, et par la possibilité de sanctions disciplinaires en cas d’examen positif.
En dernière instance, le Conseil d’État donne finalement raison à l’entreprise. "Il introduit une nouvelle doctrine en matière de tests salivaires : ils sont tolérables dès lors qu’un minimum de garanties sont préservées", résume l’avocate Jamila El Berry lors d’une conférence consacrée à la question qui s'est tenue le 14 novembre 2017.
Lire aussi : Le supérieur hiérarchique peut pratiquer un test salivaire de dépistage de drogue
Le Conseil d’État explique que :
- Le test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants n’est pas un examen de biologie médicale : donc sa mise en œuvre ne requiert pas l’intervention d’un médecin du travail.
- Comme le test présente un risque d’erreur, le salarié peut demander une contre-expertise médicale, dont le coût est à la charge de l’employeur.
- Les tests et le fait qu’ils peuvent entraîner des sanctions ne portent pas atteinte aux libertés individuelles. Certes le test n’établit qu’une consommation récente sans apporter la preuve que le salarié est encore sous l’emprise et donc inapte à exercer son emploi, mais il ne concerne que les postes hypersensibles, le supérieur hiérarchique respecte le secret professionnel, l’employeur a pour obligation d’assurer la sécurité de ses salariés, et il n’existe pas encore d’autre méthode.
Secret médical entaché ?
 "Je pense que nous allons avoir beaucoup de contentieux disciplinaires", prophétise Jamila El Berry. Les nombreux questionnements entendus lors de la conférence ne semblent pas lui donner tort. Bertrand Fauquenot, de l'ANPAA (association nationale de la prévention en alcoologie et addictologie), rapporte que depuis quelques mois, nombreuses sont les entreprises qui se tournent vers l'association pour répondre à leurs interrogations. "Comment est-ce que je retire mon salarié de son poste ? Qui se charge de sa protection immédiate ? Combien de temps attendre avant la reprise de poste ?" entend-t-il souvent, par exemple. Ici, il prodigue les mêmes conseils que pour les retraits après un accident du travail.
"Je pense que nous allons avoir beaucoup de contentieux disciplinaires", prophétise Jamila El Berry. Les nombreux questionnements entendus lors de la conférence ne semblent pas lui donner tort. Bertrand Fauquenot, de l'ANPAA (association nationale de la prévention en alcoologie et addictologie), rapporte que depuis quelques mois, nombreuses sont les entreprises qui se tournent vers l'association pour répondre à leurs interrogations. "Comment est-ce que je retire mon salarié de son poste ? Qui se charge de sa protection immédiate ? Combien de temps attendre avant la reprise de poste ?" entend-t-il souvent, par exemple. Ici, il prodigue les mêmes conseils que pour les retraits après un accident du travail.
Édouard Rauline, fondateur d'un laboratoire qui commercialise de tels tests, remarque que la demande a augmenté depuis l'arrêt du Conseil d'Etat. "Les grosses entreprises avaient déjà identifié la question et étaient déjà en négociation. Les petites entreprises ont encore peu de connaissances mais se saisissent du sujet", observe-t-il.
Lire aussi : Médecins et sociologues se creusent les méninges sur le lien entre addiction et organisation du travail
"Si c'est ça, je rends mon chapeau !", s'exclame l'une des médecins du travail présents. Elle a été étonnée d'apprendre que les tests salivaires commandés en masse par une société de transport adhérente de son service interentreprise permettaient de préciser quelles substances avaient été détectées... y compris la méthadone, opiacé de synthèse utilisé dans le traitement de la dépendance à l'héroïne. Pour elle, que l'employeur utilise de tels tests est clairement contraire au secret médical. Une inquiétude qui n'est pas partagée par l'ensemble de ses confrères.
Aux interrogations s'ajoute l'absence de certification pour ces tests. Un autre problème déontologique se pose au sujet de la contre-expertise : plusieurs médecins se demandent qui doit s'en charger. L'une d'entre eux a déjà vu plusieurs entreprises vouloir faire appel à leur infirmière de service autonome pour le réaliser. Or, contrairement aux médecins, ces personnes n'ont pas le statut de salarié protégé.
Tolérance zéro ?
Mais des tests pour quoi faire, au juste ? Ce contrôle s'inscrit-t-il dans une démarche de prévention ? Alors même qu'il en commercialise, Édouard Rauline répète qu'il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer. Il faudra par exemple définir où placer le seuil de détection, sachant qu'on peut encore contenir de la drogue dans son corps sans être encore sous son emprise. Les tests peuvent par exemple repérer la présence de cannabis dans la salive huit heures après que la personne l'a fumé. La question se posait déjà pour les éthylotests, chargés de contrôler la présence d'alcool. Mais là, le choix était plus simple : tolérance zéro ou limite autorisée par le code de la route.
Édouard Rauline conseille en général à ses clients de placer un seuil de détection à 75 nanogrammes par millilitre, mais ces recommandations ne répondent pas à la problématique de l'accoutumance au cannabis, reconnue par les études scientifiques. Avec une même dose, un consommateur régulier ressentira moins les effets de la drogue qu'une autre personne. Difficile donc, pour l'entreprise, de fixer un seuil au-delà duquel la personne est encore sous emprise.
Les sanctions disciplinaires posent aussi problème. Tout d'abord, à cause des "faux positifs". Ensuite, "avec le principe de non discrimination, on ne peut pas licencier en cas de raison de santé, rappelle Charline Robinaud, doctorante en droit du travail. Or, si le salarié est dépendant, il est malade, on ne peut donc pas le sanctionner". En résumé, toutes les interrogations autour de ces tests sont causées par le fait qu'ils prennent en compte le produit, et non son usage.
Lien entre drogues et accidents du travail
Renaud Crespin, chargé de recherche au CNRS fervent pourfendeur des tests salivaires au travail, rappelle que leur utilisation nous vient des États-Unis, où d'après lui, ils ont été généralisés grâce au lobbying des entreprises les commercialisant, et non pour des raisons de santé.
"Il n'y a pas de lien documenté entre consommation de drogue et effets en matière d'accidents du travail", fait-il remarquer. Dans sa synthèse de la revue de littérature sur les consommations de substances psychoactives en milieu professionnel, l'OFDT (observatoire français des drogues et des toxicomanies) le reconnaît, avant de préciser : "De telles études sont sans doute difficiles à mettre en place en l’absence de dépistage systématique de la présence de substances psychoactives en cas d’accident de travail".
Auteur : Pauline Chambost, actuEL-HSE.










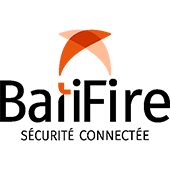




lalie le :
Webmaster le :
Bonjour. Je pense que le mieux est de demander à la médecine du travail ou à l’inspection du travail qui pourront vous orienter dans les possibilités.