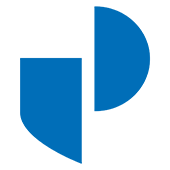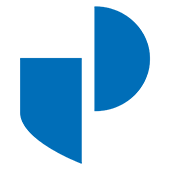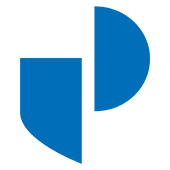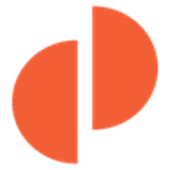Une “meilleure réglementation” ? Qui pourrait donc s’opposer à cette formule ? C’est comme si l’on vous demandait si vous avez des objections contre le beau temps. Derrière l’étiquette accrocheuse, le contenu du flacon est une amère potion. De quoi s’agit-il au juste ? L’idée de base peut se résumer en deux points.
Le premier est affirmé de façon explicite, le second est implicite :
1. Toute règle publique risque d’entraver le développement des entreprises, en particulier lorsque celles-ci sont tenues de respecter des obligations imposées par la société et de rendre compte de leurs activités sous des formes diverses. Il s’agit donc de réduire la charge administrative des entreprises et, en particulier, leurs obligations d’information ;
2. Une règle juridique n’est bonne que si elle assure le développement de l’économie. La légitimité d’une intervention publique doit se mesurer par des calculs d’impact qui supposent différents modèles d’évaluation des coûts et des bénéfices.
Ces idées remontent à la présidence de Ronald Reagan au début des années 80. Pour l’ancien président des Etats-Unis, l’Etat n’était pas la solution aux problèmes, il était le problème. Affirmation paradoxale de la part de celui qui fut le chef de l’Etat le plus puissant du monde, aux commandes d’un appareil militaire sans précédent. La notion de dérégulation trouva des échos favorables dans la Grande-Bretagne de Mme Thatcher. L’arrivée au pouvoir du New Labour introduisit quelques nuances sans jamais rompre avec cet héritage.Pour sa part, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a constitué une sorte de laboratoire idéologique de la dérégulation en organisant la coopération entre les dérégulateurs des principaux pays industrialisés. L’OCDE promeut les modèles de calcul des coûts administratifs qui ont séduit la Commission présidée par M. Barroso. Ces modèles fournissent des résultats dont la fiabilité est presque nulle. Mais qu’importe. Le calcul économique n’est ici qu’un prétexte. L’essentiel est ailleurs : il s’agit de développer l’autorégulation par les entreprises, de réduire les informations qu’elles doivent transmettre aux autorités publiques, à leurs travailleurs ou aux consommateurs. L’enjeu est plus politique qu’économique. En accordant au patronat un pouvoir accru, on met en place un système de décision politique qui tend à le débarrasser des inconvénients du suffrage universel.
L’actuelle débâcle financière aurait pu refroidir les ardeurs des dérégulationnistes. Elle apporte un nouveau démenti à la vieille croyance libérale selon laquelle la somme des égoïsmes individuels culminerait dans le bonheur collectif. Des sommes colossales sont engagées pour sauver le système financier mais le bilan politique de 25 années de dérégulation n’est pas tiré.
En santé et sécurité au travail, la direction choisie par la Commission remet en cause toute l’orientation suivie depuis 1989. Les obligations d’information représentent l’apport essentiel des directives communautaires dans la mesure où celles-ci entendent mettre en place une gestion systématique des problèmes de santé et de sécurité. Pas de gestion possible sans recueillir, conserver et traiter l’information. Pas de participation des travailleurs sans la communication et la discussion de cette information. Pas de contrôle possible des autorités publiques sans information de la part des employeurs. Réduire les obligations d’information signifie inévitablement réduire l’efficacité de la prévention. L’économie réalisée sur les coûts administratifs sera chèrement payée par les travailleurs et la société sous la forme de maladies et d’accidents causés par le travail.
La couverture idéologique des “meilleurs régulateurs” est la défense des petites et moyennes entreprises (PME). Il importe de détruire ce mythe. Toutes les études disponibles montrent que le temps accordé à la prévention dans les PME est dérisoire. Loin de préconiser une réduction des obligations de gestion des PME en matière de santé et de sécurité, une stratégie de prévention suppose un renforcement de celles-ci. Le véritable problème concerne l’efficacité bien plus que la quantité. Trop souvent, les PME passent par des consultants extérieurs dont l’intervention est souvent purement formelle et dont les coûts peuvent être très élevés. Dans ce domaine, c’est précisément l’absence de réglementation qui a un coût et qui représente une entrave. C’est bien le paradoxe des charges des rhinocéros. Ils foncent vers un objectif qui, le plus souvent, n’est qu’un leurre. L’objectif réel est ailleurs. Ils ne le voient pas et ils ne s’en soucient pas le moins du monde.
Auteur : Laurent Vogel, Directeur du département Santé et Sécurité, Institut syndical européen (ETUI)