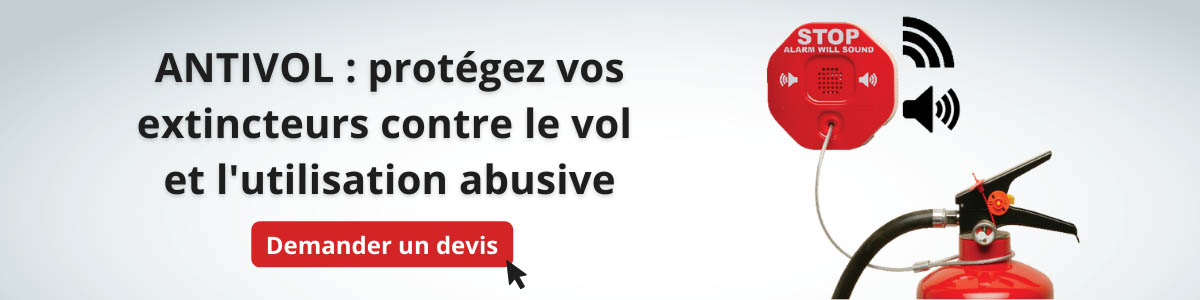Après une directive européenne de 2004 jamais réellement entrée en vigueur (voir notre article), la nouvelle directive (2013/35/UE) fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux travailleurs exposés à des champs électromagnétiques a enfin été publiée il y a un an (voir notre brève). Les États membres ont jusqu'au 1er juillet 2016 pour la transposer. "Les différents textes se sont succédés pour tenter de simplifier les choses mais le résultat final est encore plus compliqué", estime Martine Souques, médecin dans le service des études médicales d'EDF. "En basses fréquences, au lieu d'avoir deux valeurs déclenchant l'action, une pour le champ électrique et une pour le champ magnétique, nous en avons cinq !"
Les VA garantes des VLE
La directive définit d'abord des valeurs limites d'exposition (VLE) : exprimées en champ électrique et en intensité de courant traversant le corps humain, elles ne sont pas directement mesurables dans le cadre d'une évaluation des risques, car internes au corps humain. Compte tenu de cette impossibilité, la directive introduit les valeurs déclenchant l'action (VA) pour assurer le respect des VLE. Les VA sont exprimées en champ électrique et en champ magnétique ou induction magnétique, ce qui permet de les relier directement au champ électromagnétique présent dans l'environnement de travail. Si l'évaluation des risques montre que les VA ne sont pas respectées, l'employeur doit alors vérifier que les VLE le sont.
Qui est exposé à des champs électromagnétiques ?
Lignes de transport électrique, transformateurs, alternateurs, mais aussi équipements d'imagerie médicale tels que l'IRM, sont des sources d'expositions aux champs électromagnétiques assez connues. Elles ne sont pas les seules : en 2011, l'INRS et les centres de mesures physiques des Carsat ont mené une étude sur l'exposition en milieu industriel, identifiant huit familles d'applications qui émettent particulièrement : électrolyse industrielle, soudure et fusion électrique, chauffage par induction, chauffage et soudage par pertes diélectriques, magnétisation et démagnétisation industrielles, magnétoscopie, chauffage et séchage industriels par micro-ondes, utilisation des appareils IRM ou RMN (voir notre article).
Pas de consensus sur les effets à long terme
 La directive 2013/35/UE couvre l'ensemble des effets produits par des champs électromagnétiques. "Elle ne prend en compte que les effets à court terme, il n'y a toujours pas de consensus sur ceux à long terme", précise Martine Souques. L'article 8 exige une surveillance médicale appropriée des travailleurs exposés. "C'est là toute la question : qu'est une surveillance médicale appropriée ? Quels niveaux d'exposition et pour quels travailleurs ? Dans quel cas faut-il réaliser un examen clinique ou des examens complémentaires ?"
La directive 2013/35/UE couvre l'ensemble des effets produits par des champs électromagnétiques. "Elle ne prend en compte que les effets à court terme, il n'y a toujours pas de consensus sur ceux à long terme", précise Martine Souques. L'article 8 exige une surveillance médicale appropriée des travailleurs exposés. "C'est là toute la question : qu'est une surveillance médicale appropriée ? Quels niveaux d'exposition et pour quels travailleurs ? Dans quel cas faut-il réaliser un examen clinique ou des examens complémentaires ?"
Importance de la prévention
La directive 2013/35/UE peut donc laisser les médecins du travail, en charge de l'aptitude et du suivi des travailleurs, sans voix. Elle insiste bien sur l'importance de la prévention en précisant que "le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques peut être réduit plus efficacement par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source". Une stratégie autour de la prévention partagée par les Carsat (caisses d'assurance retraite et de la santé au travail), qui souhaiteraient aller au-delà des mesures des champs électromagnétiques et mettre en avant la réduction des expositions.
Réduire les expositions
Stéphane Tirlemont, de la Carsat Nord-Picardie mise sur la prévention : "Lors de nos interventions en entreprise, de plus en plus nombreuses, nous préconisons des solutions pour réduire les expositions, comme par exemple l'éloignement du poste de travail". "À EDF, nous ne pouvons pas réduire les champs, nous travaillons donc différemment, en suivant spécifiquement les salariés exposés à risque particulier, comme les porteurs d'un implant cardiaque par exemple", précise Martine Souques. Pour aider les différents acteurs à mieux appréhender la nouvelle directive, un guide devrait être publié fin 2015, six mois avant la date d'application du 1er juillet 2016. Mais Martine Souques doute qu'il réponde à toutes les questions.
Que faire pour les personnes avec un implant cardiaque ?
La directive précise que l'employeur doit réaliser des évaluations de risque individuelles pour les travailleurs à risque particulier, c'est-à-dire notamment ceux ayant un pacemaker. Là encore, Martine Souques reste perplexe, la directive ne précisant pas de VLE ni de VA pour ces travailleurs. Pour aider le médecin du travail à définir une aptitude pour un travailleur implanté exposé, EDF a – avec le fabricant de l'implant et le cardiologue concerné – évalué le fonctionnement de l'implant cardiaque d'un agent ERDF exposé à un champ magnétique 50 Hz et d'un pompier exposé à des radiofréquences. Des "évaluations compliquées" qui "ne peuvent être mises en place que dans de grandes entreprises comme EDF", souligne Martine Souques. La principale conclusion de cette évaluation est qu'il est quasiment impossible d'éviter le cas par cas, face à des modèles d'implant très nombreux, avec des réglages différents, et implantés sur des travailleurs ne souffrant pas des mêmes pathologies.
Auteur : Par Clémence Lamirand / Elodie Touret, actuEL-HSE.
Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.