Organiser un référendum, comme Séphora, pour demander aux salariés s’ils sont favorables à l’ouverture de l’entreprise après 21h est-il un signe extérieur de QVT (qualité de vie au travail) (voir notre brève) ? Ou est-ce juste se conformer à son obligation de prise en compte des conditions de travail des salariés quand un changement de stratégie ou d’organisation s’amorce ? "Restons-en à l’idée qu’il est important que les salariés puissent s’exprimer", préfère Jean-Pierre Berthet, représentant de la DGT (direction générale du travail) au salon Préventica, qui s'est hier ouvert pour trois jours à Lyon. Pour Hervé Lanouzière, directeur général de l’Anact, cette possibilité de s'exprimer fait partie des "fondamentaux oubliés par les entreprises ces dernières années". Des fondamentaux qui seraient englobés dans la qualité de vie au travail. "En réalité, avec la QVT, il s’agit de ne pas dissocier le projet de l’humain", souligne-t-il. "C’est se poser la question des conditions de travail dès le début d’un projet". Bien avant de se poser celle des massages à l'heure du déjeuner, comme on voudrait nous le faire croire de colloques en formations.
"L’entreprise perdait de l’argent"
Jeanne Servy est responsable de la santé et de la sécurité au travail au sein d’une PME ardéchoise qui emploie une quarantaine de personnes pour transformer des marrons. Elle y a engagé une démarche sur la santé au travail et la performance, présentée à Préventica dans le cadre d’une réunion sur la... QVT. "Nous avions des postes difficiles, avec de la manutention manuelle et des ports de charges lourdes", se souvient-elle. "Et puis nous avions un passif lourd au niveau de l’encadrement, qui était auparavant très répressif". Faute de prendre en compte la santé physique et morale de ses salariés, "l’entreprise perdait de l’argent chaque année", résume Jeanne Servy, "et plus personne ne voulait y travailler". Elle s’est donc attaquée à ce que certains appellent donc de la QVT : l’aménagement des postes de travail et la prise en compte des travailleurs lorsqu’ils sont à ces postes. Après quelques semaines de pratique, "on sent déjà que cela fait du bien", raconte-t-elle. A-t-elle pour autant recouru à l’ANI de 2013 sur la QVT et l’égalité professionnelle ? "Pas du tout", nous répond-elle.
Relire l’ANI 2013, utile ?
Pourtant sa démarche est dans la droite ligne de ce que dit l’accord national interprofessionnel. "Dans l’ANI – que beaucoup de gens ont lu en se disant que c’était du blabla, des portes enfoncées – les partenaires sociaux disent bien que la QVT, c’est s’intéresser aux conditions de travail", rappelle Hervé Lanouzière. Et les salles de siestes au bureau ? "Pour nous, c’est une sorte de cerise sur le gâteau", répond le DG de l’Anact. "Au fond", poursuit-il, "la QVT ce n’est rien de nouveau". Assiste-t-on à un retour aux fondamentaux ? À une évolution du concept décliné à toutes les sauces depuis plusieurs années ? "C’est l’appropriation du concept par les entreprises qui évolue", rectifie-t-il. "Aujourd’hui", confirme Jeanne Servy, "on voit dans le cadre de notre programme que considérer la santé des gens – physique et morale –, considérer l’humain à son poste de travail est important car les générations qui arrivent ne veulent plus travailler comme leurs grands-pères. Ils ne resteront pas chez nous si nous ne changeons rien."
Entreprise cherche "plan tout fait"
 À côté de l’ANI 2013, certains outils plus concrets existent pour aider les PME dans leur démarche QVT. L’INRS planche par exemple sur les procédés de travail tel la robotique, capables de soulager certaines contraintes physiques et vient de dévoiler un outil de conception des locaux en bonne intelligence avec les bases de l’ergonomie (voir notre brève). L'Anact fait de son côté une large promotion des "espaces de discussion" depuis quelques mois (voir notre article). Un certain nombre de programmes d'accompagnement ou de financement sont par ailleurs mis en place sur le sujet. La PME dans laquelle travaille Jeanne Servy s’est lancée suite à une proposition d’aide de la Carsat Rhône-Alpes : il s'agit du programme "Rhône-Alpes gourmand", dédié aux entreprises de l’agro-alimentaire. À charge aux employeurs et chargés de QSE de personnaliser ensuite la démarche, sous peine de raté. "Certaines entreprises attendent peut-être un plan tout fait", constate Hervé Lanouzière. "On ne peut rien pour elles si elles cherchent une solution miracle avec un plan qu’elles vont simplement coller sur leur problème. Cela ne marchera pas et elles auront des problèmes d'absentéisme, de performance globale..."
À côté de l’ANI 2013, certains outils plus concrets existent pour aider les PME dans leur démarche QVT. L’INRS planche par exemple sur les procédés de travail tel la robotique, capables de soulager certaines contraintes physiques et vient de dévoiler un outil de conception des locaux en bonne intelligence avec les bases de l’ergonomie (voir notre brève). L'Anact fait de son côté une large promotion des "espaces de discussion" depuis quelques mois (voir notre article). Un certain nombre de programmes d'accompagnement ou de financement sont par ailleurs mis en place sur le sujet. La PME dans laquelle travaille Jeanne Servy s’est lancée suite à une proposition d’aide de la Carsat Rhône-Alpes : il s'agit du programme "Rhône-Alpes gourmand", dédié aux entreprises de l’agro-alimentaire. À charge aux employeurs et chargés de QSE de personnaliser ensuite la démarche, sous peine de raté. "Certaines entreprises attendent peut-être un plan tout fait", constate Hervé Lanouzière. "On ne peut rien pour elles si elles cherchent une solution miracle avec un plan qu’elles vont simplement coller sur leur problème. Cela ne marchera pas et elles auront des problèmes d'absentéisme, de performance globale..."
Un problème de langage ?
Le chemin n’est pas exempt de difficultés, même lorsque l’entreprise se saisit vraiment du problème. Jeanne Servy, comme nombre de responsable QSE mettant les mains dans le cambouis sur ces sujets, dit faire face à "des salariés qui sont convaincus que ça ne sert à rien". Elle raconte aussi que dans son entreprise, malgré le lancement de la démarche, "les gens craignent de s’impliquer, de peur qu’on leur dise qu’ils font mal leur travail et qu’on les sanctionne". "Nous devons leur montrer que nous sommes là pour les écouter sur le sujet", poursuit-elle, "et qu’ils sont de vrais acteurs pour faire avancer l’entreprise". En attendant, il reste "très difficile de les faire parler de leur travail". La DGT a beau vouloir "passer d’une vision pathogène à une vision positive du travail", la transition va prendre du temps. Et lorsque l’on parle de QVT alors qu’on devrait parler d’aménagement de poste, de réduction de la pénibilité, bref, de prise en compte des conditions de travail, il y a, c'est vrai, de quoi en perdre son latin.
Auteur : Par Claire Branchereau, actuEL-HSE.
Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.








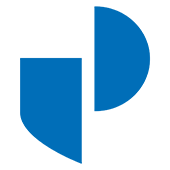
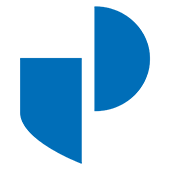
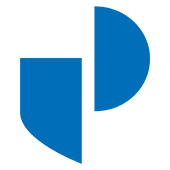
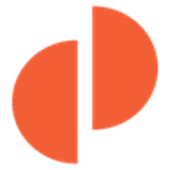


Convention.fr le :