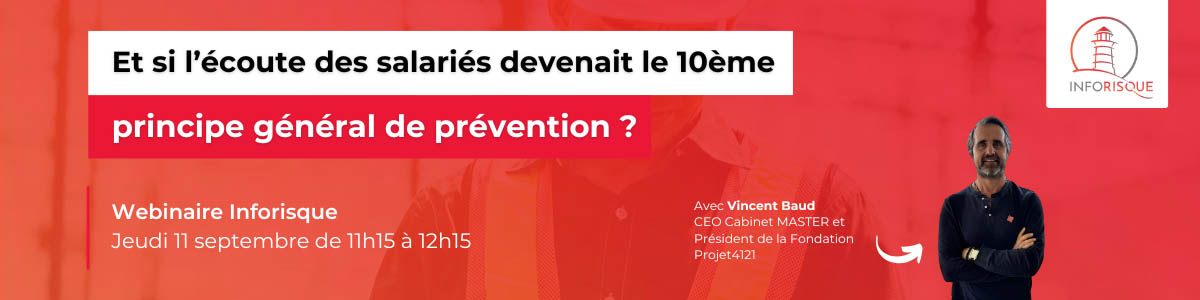Tout juste 10 ans. Dix ans que l'usine AZF à Toulouse a explosé. Marquant l'histoire de la sécurité industrielle d'une pierre noire. Les médias sont largement revenus sur les changements législatifs et règlementaires intervenus après ce drame (voir le communiqué du ministère) ou encore sur les séquelles dont souffre toujours les victimes qu'elles soient des employés de l'usine ou non (voir cet article). "Gilbert de Terssac*, sociologue au Centre de recherche "Travail, Organisation et Pouvoir" et Jacques Mignard, ancien animateur sécurité d'AZF se sont eux intéressés à l'évolution de la politique de sécurité dans cette usine pendant 20 ans. Une histoire de progrès foudroyée en plein vol.
Les deux paradoxes de la sécurité industrielle
Gilbert de Terssac reconnaît dans la "sécurité industrielle" et tout particulièrement dans le cas d'AZF, deux réalités contradictoires : d'une part des efforts d'amélioration de la sécurité et d'autre part la survenue d'un d'un accident majeur. C'est ce qu'il présente comme le premier paradoxe. Le second tient lui aux deux réalités des règles de sécurité. Il distingue ainsi les règles formelles, écrites qu'il faudrait appliquer pour minimiser les risques et d'autre part les règles réelles du terrain qui en sont la traduction et la transformation concrète sur le terrain. L'analyse de la politique de sécurité au sein d'AZF a amené les auteurs à distinguer plusieurs phases, qui se retrouvent dans d'autres organisations.
1960-1980 : la sécurité dégradée
Ces années-là sont emblématiques de l'absence même d'une politique de sécurité. "Les pratiques sont limitées à des actions curatives", écrit l'auteur. Des actions menées en urgence assorties de quelques règles minimalistes (comme le port du casque) mais sans aucun suivi ou sans vérifier que les messages sont compris et que les travailleurs se les approprient. Les taux de fréquence d'accidents du travail atteignent des plafonds de 50 ou 60% avec 8 à 10 accidents graves par an. Au niveau de la gouvernance, les relations direction / représentants du personnel sont uniquement conflictuelles. La direction porte son regard sur la production et se contente de gérer la sécurité technique alors que les syndicats se font l'écho des revendications et de la sécurité des hommes mais n'estiment pas avoir à s'occuper de l'organisation de la production.
1980-1983 : phase expérimentale - l'engagement incitatif
L'usine de Toulouse, montrée du doigt au sein du groupe industriel (à l'époque ELF-Chimie), finit en 1980 par se lancer dans une politique de sécurité plus construite. Le projet d'amélioration de la sécurité pour lutter contre le taux d'accidents du travail se met donc en place. Il va transformer petit à petit le travail, les relations de pouvoir et les mentalités. Cette première période de 3 ans est caractéristique du début d'un engagement, l'auteur le qualifie d'engagement incitatif, le contrôle de l'application des règles est encore faible aussi la sécurité dépend surtout d'un engagement d'un petit groupe de personne convaincue composée essentiellement de quelques représentants de la direction, des responsables sécurité et des membres du CHS.
Des régulations parallèles
Chez AZF, les débuts de la politique sécurité sont téléguidées directement depuis la direction du groupe. Néanmoins, la volonté (même forcée) de faire baisser les accidents et de structurer la sécurité via un nouveau service sécurité marque un tournant. Ce tournant implique pour la direction d'écouter les recommandations d'un autre, en l'occurence le chef du service sécurité et pour les membres du CHS et syndicaliste de changer de positionnement. Ils ne peuvent plus être dans l'opposition systématique. Ils laissent alors la direction prendre des initiatives en matière de sécurité et en parallèle commencer un travail de prévention et de lanceur d'alerte qui nécessite d'aller sur le terrain "faire parler" les ouvriers, souvent enfermés dans un mutisme par peur de la répression. Si les deux parties ne s'opposent plus constamment, elles ne travaillent pas encore de concert.
1983-1987 : phase de généralisation - l'engagement coercitif
Malgré le changement entamé et des accidents en baisse, les résultats sont encore mitigé et surtout l'adhésion au projet d'amélioration de la sécurité loin d'être partagé. Aussi, une nouvelle impulsion va être donnée : elle va passer par un renforcement des dispositifs de contrôle avec mise en place de sanctions. Ce changement de cap va être rendu possible par un changement à la direction, là encore piloté par le groupe. Le nouveau directeur est choisi pour son ouverture à la sécurité. Les premières personnes visées par cette politique sont les cadres : désormais les chefs de services ne sont plus jugés aux seuls résultats de la production mais aussi à ceux de la sécurité. Et des têtes tombent quand les engagements ne sont pas tenus.
La sécurité est aussi une affaire de famille
Le nouveau directeur impulse donc une dynamique très particulière. Et après avoir responsabiliser de force les cadres, il va innover en matière de communication auprès des salariés en envoyant une lettre personnalisée au domicile de chacun d'entre eux pour présenter son plan d'action pour la sécurité. Gilbert de Terssac écrit ainsi : "s'adresser aux personnes par lettre reue dans leur espace privé, c'est considérer que le problème dépasse le cadre de l'univers professionnel qu'est l'usine et que la lecture d'une telle lettre aur d'autant plus de chances de toucher [...] qu'elle est probablement lue en famille."
Le CHSCT devient allié de tous et reconnu
Dans ce contexte, les élus du CHSCT se repositionnent eux aussi. La remontée d'information qu'ils sont susceptibles d'apporter est reconnue et prise en compte. Si bien qu'ils acquiert aussi une légitimité de la part des salariés. Il sert de médiateur dans les relations employé-employeur.
1988-2001 : phase de relance - l'engagement consenti
En 1987, les résultats sont là : le taux d'accident est proche de zéro, les analyses d'accidents sont faites de manière systématique, les EPI sont portés etc. Mais de 1988 à 1990, on sent l'essoufflement et le poids des habitudes. Le service sécurité se désorganise en raison du départ de son chef et de deux animateurs. Le directeur de l'usine change lui aussi. Les résultats de sécurité se dégradent. En 1990, une relance est donc amorcée. Elle prend aussi une forme plus moderne qui va passer par la production d'écrits. C'est les débuts du document unique. C'est aussi la période où l'usine va devoir intégrer une démarche qualité demandée par le groupe. La sécurité va passer par le même type de management et s'orienter vers un mode de régulation des relations par voie contractuelle : les parties doivent s'accorder sur l'élaboration de règles communes et s'engager à les respecter. C'est ce que le sociologue nomme la "sécurité négociée". Dans cette phase, l'objectif est désormais d'impliquer les acteurs sur de nouveaux sujets : gestion des savoirs et retour d'expérience. Cet état abouti de collaboration entre les parties est habituellement le plus propice à la sécurité. Dans le cas d'AZF, c'est pourtant à ce moment que le pire arrive. Un paradoxe de plus...
S'approprier les règles et comprendre sans punir
L'ouvrage de Gilbert de Terssac et de Jacques Mignard abordent à travers l'exemple d'AZF bien d'autres sujets liés à l'organisation du travail et ses impacts sur la sécurité. Un chapitre est ainsi consacré aux modes d'appropriation des règles tant du point de vue des ouvriers que de celui des concepteurs même des règles. Un autre décortique comment les mentalités ont dû passer d'une logique de punition à l'impunité pour réussir à partager la sécurité. Enfin un chapitre s'intéresse au passage de la culture orale à celle de l'écrit et des règles qu'il a fallu émettre pour coordonner et homogénéiser les messages.* Cet article s'appuie à la fois sur le livre "Les paradoxes de la sécurité - le cas AZF" aux éditions du PUF ainsi que sur la présentation faite par son auteur à l'occasion de la journée "Ficher, mesurer, les paradoxes du contrôle au travail" co-organisé par les revues RSEmag et Sociologies Pratiques et l'Ecole des mines de Paris.
 Auteur : Par Sophie Hoguin, actuEL-HSE.
Auteur : Par Sophie Hoguin, actuEL-HSE.
Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.