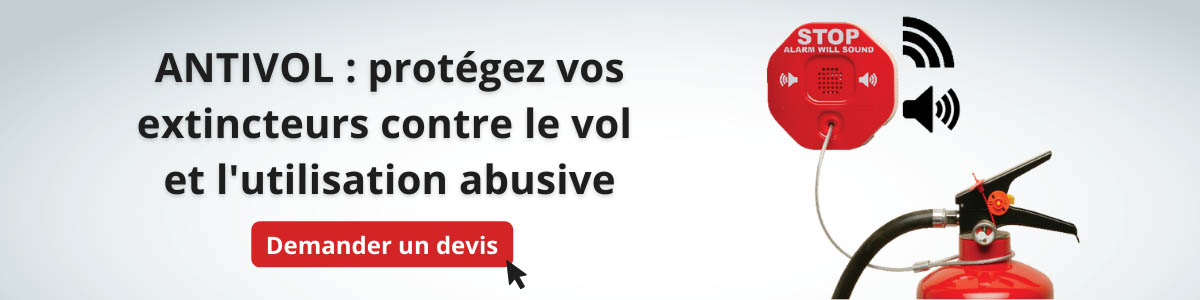Et si l’égalité n’était pas toujours synonyme de justice ?
Et si l’égalité n’était pas toujours synonyme de justice ?
On entend souvent : « Les femmes veulent l’égalité, pourquoi prévoir un traitement particulier ? »
En apparence, le raisonnement semble logique. Mais en réalité, appliquer la même règle à tout le monde sans tenir compte des différences… crée de nouvelles inégalités.
En matière de santé-sécurité, l’égalité, c’est offrir la même règle à tous.
L’équité, c’est adapter les moyens pour que toutes et tous ait les mêmes chances de rester en bonne santé.
Or, depuis toujours, la prévention a été pensée pour un seul profil : “l’homme moyen”.
Des risques invisibles… mais bien réels
Gants, outils, équipements, seuils de pénibilité : la norme est masculine. Résultat ? Des protections inadaptées et des risques sous-estimés pour les femmes.
Le rapport de la Délégation aux Droits des Femmes du Sénat* (juin 2023) met en évidence quelques chiffres percutants :
- 60 % des TMS touchent des femmes
- Le travail de nuit augmente de 26 % le risque de cancer du sein
- Les femmes signalent 3 fois plus de douleurs physiques
- Les risques psychosociaux (dépression, burn-out, anxiété) touchent 2 à 3 fois plus les femmes
- 1 sur 5 déclare avoir subi des violences sexistes ou sexuelles au travail
Ces réalités sont encore trop souvent minimisées ou renvoyées à la sphère « personnelle ». Pourtant, elles pèsent lourd sur la santé et la sécurité.
Une prévention calibrée pour un autre corps
Les femmes sont majoritaires dans des secteurs exigeants : santé, enseignement, commerce, services à la personne…
Ces métiers cumulent :
- Travail debout prolongé
- Horaires étendus
- Peu de pauses
- Forte intensité émotionnelle et relationnelle
À cela s’ajoutent des situations spécifiques – grossesse, allaitement, ménopause, endométriose – encore absentes des politiques de santé au travail.
Quand l’exemple vient de l’automobile…
Le problème dépasse largement le cadre professionnel.
Examinons un exemple très parlant : celui de la ceinture de sécurité dans les voitures.
Dans l’industrie automobile, les crash-tests sont longtemps restés basés sur un mannequin d’”homme moyen”.
Les femmes, du fait de leur morphologie, sont donc plus exposées : une étude de l’Université de Virginie (2011) révèle un risque 47 % plus élevé de blessures graves en cas d’accident.
Les mannequins dits « féminins » introduits depuis ne sont souvent que des versions réduites du modèle masculin, ignorant la répartition réelle des masses et la souplesse articulaire différente.
C'est incroyable de se dire que même en voiture, les femmes sont moins protégées !
Passer des intentions aux actes
Heureusement, des initiatives existent.
En Bretagne, le Plan Régional Santé Travail a intégré dès 2021 des critères spécifiques aux femmes dans le DUERP, avec l’objectif de sortir d’une lecture neutre des risques. **
Chez Carrefour, un dispositif d’accompagnement des salariées atteintes d’endométriose a vu le jour : sensibilisation des managers, adaptation temporaire des postes, accès facilité à un suivi médical et psychologique. L’entreprise a également ouvert des mesures pour mieux prendre en compte les fausses couches et la PMA. ***
Changer d’échelle
Si ces exemples sont encourageants, ils restent isolés. Pour transformer durablement la prévention, il faut :
- Former tous les acteurs de la santé au travail à l’approche genrée
- Repenser les organisations, outils et EPI en fonction de toutes les morphologies et parcours
- Intégrer ces critères dans les politiques publiques et les référentiels réglementaires
Tant que la prévention restera pensée pour “l’homme moyen”, la moitié des travailleurs restera en danger. Il est temps de changer de modèle.
Auteur : Eléana GOMEZ, Coven.
Sources :