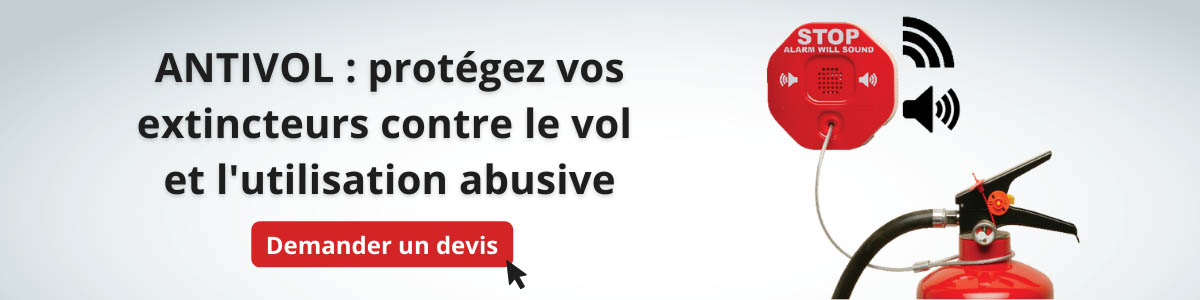Pour la 7ème édition de la SQVT, cette partie thématique portait sur les troubles musculosquelettiques (TMS). 1000 salariés - échantillon représentatif des salariés français actifs occupés de 18 ans et plus (quotas de sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle) - ont ainsi été interrogés par téléphone à leur domicile entre le 29 mars et le 3 avril 2010.
Les principaux enseignements de l'enquête sont :
"TMS" est un terme connu
L’appellation troubles musculosquelettiques (TMS) est connue par une majorité de salariés (55%) mais seulement 1/3 (35%) déclarent savoir précisément ce qu’elle recouvre.
Les salariés semblent fortement exposés aux TMS
Plus de 7 salariés sur 10 déclarent ressentir au moins une douleur associée aux TMS (72%). La localisation des principales zones d’affection se situe au dos (50%) et à l’épaule/ nuque (45%). Les autres zones du corps touchées par les TMS sont le poignet (25%), le genou (17%) et le coude (16%).
Les salariés ne semblent pas tous égaux face aux TMS
Tous les secteurs d’activités et toutes les catégories socio professionnelles sont touchés. Mais on constate que les plus exposés à ces douleurs sont les ouvriers, les salariés des secteurs du BTP ou de l’industrie/énergie ainsi que les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté. Les TMS constituent un véritable désagrément pour une partie des salariés concernés, tant au niveau de l’intensité (22% déclarent insupportables/fortes) que de la gêne occasionnée (65% déclarent qu’elles les gênent beaucoup/un peu).
Un lien évident entre les douleurs ressenties et les conditions de travail : l’entreprise et le cadre de travail sont pointés du doigt par une grande partie des salariés qui souffrent de ces troubles. Plus des ¾ des salariés attribuent les TMS à l’exercice de leur métier (dont 25% totalement et 52% en partie). Les ouvriers, les salariés de PME et les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté attribuent encore davantage leur TMS à l’entreprise.
La quasi totalité des salariés (96%) est exposée à au moins un risque « organisationnel » ou « biomécanique »
Plus précisément, 87% se déclarent confrontés à au moins un risque organisationnel : le travail dans l’urgence (74% des salariés s’y déclarent confrontés), le sentiment d’être débordé (58%), les aléas, incidents ou dysfonctionnement (50%) sont les principaux déterminants mis en avant sur l’aspect organisationnel.
De plus, 73% des salariés estiment être soumis à au moins un risque biomécanique : position statique (40%), répétitivité des gestes (39%), minutie et précision des gestes (33%), efforts physiques (32%) ou postures inconfortables (31%).
La très grande majorité des salariés a le sentiment de bénéficier de facteurs protecteurs (autonomie, soutien, liberté) à l’apparition de TMS
91% des salariés déclarent qu’ils disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, 83% qu’ils ont les moyens de faire un travail de qualité. 80% des salariés interrogés estiment qu’ils ont reçu la formation suffisante pour faire leur travail, 80% également que leur poste de travail leur autorise une grande liberté de mouvement, 79% qu’ils peuvent compter sur le soutien de leurs collègues en cas de difficulté. Toutefois, moins des 2/3 des salariés (63%) déclarent pouvoir bénéficier d’un soutien de leur hiérarchie.
Les salariés en parlent principalement à leur médecin traitant
Les TMS sont un sujet qui semble encore difficile à aborder dans la sphère professionnelle, peut- être parce qu’il constitue un aveu de faiblesse de la part du salarié, celui-ci est peu enclin à l’évoquer avec son supérieur hiérarchique (30%), les représentants du personnel (19%) ou les responsables des ressources humaines (14%). Le salarié choisit d’abord son médecin traitant pour en discuter (81%) et, dans une moindre mesure, le médecin du travail (62%) et les collègues (62%), ces derniers assurent avant tout un rôle d’écoute.
Face à ce problème de TMS, les salariés s’adaptent
Les salariés semblent être contraints de s’adapter sans autre issue que de mettre en danger leur santé. En effet, une majorité de salariés (52%) a eu à faire face à des conséquences de ces douleurs, certains se retrouvant « en arrêt de travail » (32%) ou pire encore « quittant leur emploi » (6%), « engageant une reconversion professionnelle » (8%). Les solutions intermédiaires constituent encore l’exception à la règle « votre poste a été aménagé » (17%), « l’organisation de votre travail a été modifiée » (15%).
Les actions de prévention sont encore minoritaires et perçues comme plutôt efficaces
Des actions de prévention des TMS sont observées dans certaines entreprises mais elles sont encore minoritaires (43%) et perçues par les salariés comme étant d’une efficacité relative (68% efficaces dont 57% assez efficaces et 11% très efficaces). Pourtant les salariés faisant partie d’entreprises qui mènent des actions de prévention mettent en avant des actions diverses de la formation (72%) et la sensibilisation des salariés (67%) au changement d’organisation (55%). Le fait de solliciter un expert des TMS est moins pratiqué (40%).
Quant aux salariés d’entreprises n’ayant pas d’actions de prévention des TMS, ils manifestent de nombreuses attentes
Certaines de leurs attentes rejoignent les actions menées dans les entreprises « sensibilisation des salariés » (88%) et « formation » (83%). D’autres attentes en revanche sont en décalage par rapport aux pratiques des entreprises, comme « faire participer les salariés à l’analyse et à la recherche de solutions pour prévenir les TMS » (83%), « renforcer les équipes en cas de surcharge de travail » (81%), « le fait de résoudre rapidement les problèmes de fonctionnement » (80%) ou encore « faire appel à des experts de la question » (70%).
Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur www.qualitedevieautravail.org