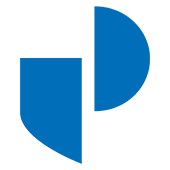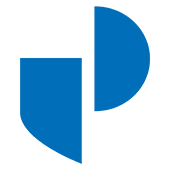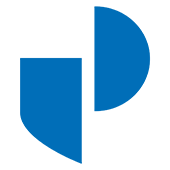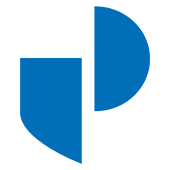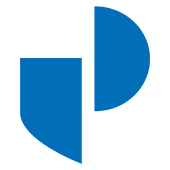![]() Rester assis des heures d’affilée n’est pas un simple inconfort : au travail, c’est un facteur de risque à part entière pour la santé métabolique, cardiovasculaire et même cognitive. Bonne nouvelle : des micro-pauses régulières, planifiées intelligemment, suffisent déjà à inverser la tendance.
Rester assis des heures d’affilée n’est pas un simple inconfort : au travail, c’est un facteur de risque à part entière pour la santé métabolique, cardiovasculaire et même cognitive. Bonne nouvelle : des micro-pauses régulières, planifiées intelligemment, suffisent déjà à inverser la tendance.
Pourquoi la sédentarité au travail inquiète
En France, on passe en moyenne près de sept heures assis chaque jour. Dans les open spaces comme en télétravail, ces temps prolongés favorisent l’installation d’un « double fardeau » : une activité physique globale insuffisante et une sédentarité excessive. Les conséquences sont aujourd’hui solidement documentées : hausse du risque de diabète de type 2, de prise de poids, de maladies cardiovasculaires, de troubles ostéo-articulaires et, pour certaines localisations, de cancers.
Des enquêtes nationales montrent par ailleurs qu’une part non négligeable des adultes cumulent plus de huit heures de position assise quotidienne, un seuil associé à des indicateurs de santé défavorables. Au bureau, ce cumul s’explique par la logique des tâches (mail, rédaction, visio, reporting) et l’ergonomie des lieux (poste fixe, réunions en salle, ascenseurs). Autrement dit : tant que rien n’est délibérément organisé pour « casser » l’immobilité, celle-ci gagne toujours.
Ce que recommande l’Anses : le rythme des micro-pauses
Les nouvelles analyses de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) convergent avec la littérature internationale : il est préférable d’interrompre la position assise fréquemment, idéalement toutes les 30 minutes. Le repère pragmatique pour les adultes au travail est simple : se lever et marcher environ cinq minutes à intensité faible à modérée toutes les demi-heures.
Ce tempo maximise les bénéfices observés sur la glycémie et l’insulinémie juste après les repas ou les collations. Au-delà de 60 minutes d’assise ininterrompue, les effets délétères s’accentuent : l’objectif est donc de ne jamais « laisser filer » une heure complète sans rupture.
À l’école, une intensité un peu plus soutenue sur des pauses plus courtes (par exemple trois minutes actives toutes les 30 minutes) renforce l’intérêt, mais au bureau le duo « fréquence + régularité » prime sur la performance. Retenez la règle d’or : petit, souvent, toujours.
Des gains mesurables : métabolisme, cerveau, fatigue
La rupture active n’est pas un simple « truc bien-être ». Les études contrôlées montrent des effets physiologiques rapides : meilleure régulation de la glycémie post-prandiale, baisse transitoire de l’insulinémie, et, sur la journée, une dépense énergétique légèrement accrue.
Côté cerveau, les bénéfices sont tout aussi concrets pour le travail de connaissance : amélioration de l’attention soutenue, du temps de réaction, de l’humeur et diminution de la sensation de fatigue. Fait intéressant : l’avantage cognitif existe même à faible vitesse de marche. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de « transpirer » entre deux réunions pour retrouver de la clarté mentale ; la clé est la régularité des interruptions.
Transformer son quotidien professionnel (sans bouleverser l’organisation)
L’approche la plus efficace consiste à combiner des déclencheurs simples, des contextes qui incitent à bouger et quelques aménagements de poste. Voici un plan d’implémentation en trois étapes :
- Programmez un rappel toutes les 30 minutes (montre, minuteur PC ou calendrier) et levez-vous dès le signal.
- Associez chaque « levée » à une micro-tâche utile : aller boire un verre d’eau, déposer un courrier, consulter un collègue, faire un aller-retour d’escalier.
- Prolongez l’habitude avec des rituels d’équipe : début de réunion debout, point téléphonique en marchant, passage régulier par un espace d’impression éloigné.
Idées concrètes à déployer dès cette semaine :
- Déplacer la corbeille, l’imprimante ou les fournitures pour créer un « prétexte » à marcher.
- Activer la caméra seulement si nécessaire en visio et suivre l’appel debout ou en déambulation quand c’est possible.
- Monter systématiquement deux étages à pied ; au-delà, prendre l’ascenseur mais descendre un étage plus tôt.
- Instaurer des « walk & talk » pour les échanges bilatéraux de moins de 20 minutes.
- Utiliser un bureau assis-debout en alternant 20–30 minutes assis / 10 minutes debout.
- Organiser les mails en « batchs » et intercaler une marche de cinq minutes entre deux lots.
Côté communication interne, positionnez la sédentarité comme un sujet de performance et de sécurité : moins de coups de barre l’après-midi, plus de vigilance en fin de journée, et potentiellement moins de troubles musculo-squelettiques.
Pour rendre l’adhésion durable, variez les opportunités (escaliers, déplacements courts, pauses debout, aller-retour au soleil) et normalisez les comportements actifs : un employé qui marche pendant un point téléphonique n’est pas « distrait », il optimise ses fonctions exécutives.
Enfin, reliez ces micro-pauses à une activité physique quotidienne globale (marche ou vélo utilitaires, ménage, jardinage, bricolage), puis, si l’envie vient, à une pratique sportive hebdomadaire : c’est l’addition du « moins assis » et du « plus actif » qui pèse sur les indicateurs de santé.
Auteur : Inforisque.Lire l'avis relatif à la révision des recommandations sur les ruptures de sédentarité.