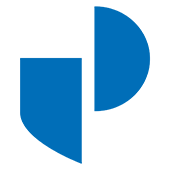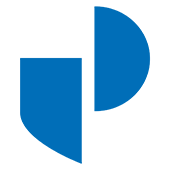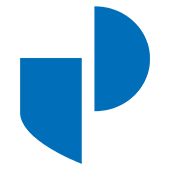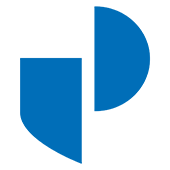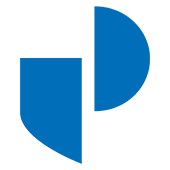Les équipements de protection individuelle ne sont pas qu’une formalité : ils conditionnent l’intégrité des équipes. Pourtant, trop d’entreprises s’exposent encore à des risques évitables en négligeant la conformité et la traçabilité. Voici comment transformer ce point faible en véritable filet de sécurité.
Les équipements de protection individuelle ne sont pas qu’une formalité : ils conditionnent l’intégrité des équipes. Pourtant, trop d’entreprises s’exposent encore à des risques évitables en négligeant la conformité et la traçabilité. Voici comment transformer ce point faible en véritable filet de sécurité.
Conformité des EPI : le talon d’Achille de la prévention
Un casque, une paire de gants, un harnais ou une visière n’ont de valeur que s’ils répondent aux exigences réglementaires. Or, les contrôles officiels montrent que la chaîne n’est pas étanche : en 2022, près de 45 % des établissements vérifiés présentaient des irrégularités de marquage, de documentation ou de traçabilité. Ce niveau d’anomalies révèle une fragilité structurelle du marché et, surtout, une exposition directe des employeurs à des risques humains, juridiques et financiers.
Pour un responsable HSE, la question n’est donc pas seulement « avons-nous des EPI ? », mais « peuvent-ils prouver leur conformité à tout moment ? ». Sans cette preuve, le dernier rempart face au danger se fissure. Les pratiques d’achat en ligne, la pression sur les coûts et la multiplicité des références accentuent encore la difficulté : la conformité devient un sujet de management, pas uniquement d’approvisionnement.
Ce que dit la réglementation : Règlement (UE) 2016/425 et Code du travail
Le cadre européen impose une logique simple : aucun EPI ne doit être mis sur le marché s’il ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité, s’il n’a pas été évalué (avec organisme notifié lorsque requis) et s’il ne porte pas un marquage CE visible, lisible et indélébile. Côté usage en France, le Code du travail interdit la vente et l’emploi professionnel d’un EPI dépourvu de marquage CE.
Trois catégories structurent les exigences : la catégorie I couvre les risques mineurs (auto-certification du fabricant), la catégorie II vise les risques intermédiaires (examen UE de type par un organisme notifié), et la catégorie III concerne les risques mortels ou irréversibles, avec examen de type et surveillance de la production. Les EPI de catégorie III nécessitent un suivi plus rigoureux, incluant des contrôles périodiques et une traçabilité complète.
Marquage, étiquetage et documents : la check-list de base
Le marquage CE n’est pas un logo décoratif : il atteste que l’EPI répond aux exigences applicables. Chaque équipement doit être livré avec ses éléments d’identification et d’usage. À vérifier systématiquement :
- Identité du fabricant ou de l’importateur.
- Référence exacte du modèle, taille et numéro de lot.
- Pictogrammes de protection et normes harmonisées associées.
- Marquage CE et, le cas échéant, numéro à quatre chiffres de l’organisme notifié.
- Notice en français précisant conditions d’utilisation, limites de protection, entretien, stockage et durée de vie.
La déclaration UE de conformité doit être disponible pour chaque référence et conservée. Pour les EPI de catégorie III (antichute, respiratoire, chimique…), un contrôle régulier par une personne compétente est indispensable, avec enregistrement dans un registre dédié. Cette discipline documentaire n’est pas administrative : elle permet de justifier la maîtrise des risques et d’accélérer les décisions de retrait lorsqu’un doute apparaît.
Rôle de l’employeur, registres et lutte contre les faux EPI
La conformité initiale relève du fabricant, mais l’employeur garantit que les EPI restent conformes pendant toute leur durée d’usage. Cela implique des vérifications à l’entrée, la conservation des notices et certificats, la formation des équipes au repérage des signaux faibles (étiquettes illisibles, marquage incohérent, documents manquants) et la tenue d’un registre EPI retraçant distribution, maintenance, contrôles et remplacements.
La vigilance s’impose face aux dérives du marché. La facilité d’achat sur certaines plateformes a favorisé l’essor d’équipements non certifiés ou affichant des marquages trompeurs. En 2023, plus de 350 000 pièces non conformes (masques, gants, lunettes…) ont été retirées du marché. Ces produits, parfois indiscernables visuellement de modèles certifiés, ne délivrent pas le niveau de protection promis et exposent l’entreprise à un risque d’accident, de poursuites et d’atteinte à la confiance interne.
Pour verrouiller le sujet, mettez en place un plan d’action pragmatique :
- Auditer l’existant : contrôle des marquages, lisibilité des étiquettes, présence des notices et correspondance références/documents.
- Numériser la traçabilité : registre EPI digital avec lots, dates de remise, contrôles, réparations et échéances de remplacement.
- Former et sensibiliser : décoder les pictogrammes, reconnaître les faux marquages, signaler tout doute et sortir immédiatement l’EPI du service.
- Sélectionner des fournisseurs de confiance : exigence de déclaration UE de conformité, rapports d’essais et certificats authentiques pour chaque référence.
- Contrôler périodiquement : surtout en catégorie III, avec traçabilité des inspections et décisions (réparation, rebut, remplacement).
La technologie devient un allié : puces RFID pour suivre le cycle de vie d’un harnais, plateformes centralisant les certificats, alertes automatiques pour les contrôles calendaires, voire EPI « connectés » capables de signaler un choc ou une exposition excessive. Ces outils ne remplacent pas la responsabilité de l’employeur, mais ils rendent la conformité visible, partageable et vérifiable en un clic.
Au final, la conformité n’est pas un supplément bureaucratique : c’est l’architecture invisible qui soutient votre culture sécurité. Un étiquetage lisible, un certificat à jour et un registre tenu avec rigueur pèsent aussi lourd qu’un bon équipement : ils transforment un EPI en véritable garantie de protection.
Auteur : Inforisque.Voir le dossier complet du Synamap : EPI, la sécurité commence par la conformité.