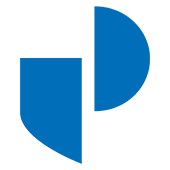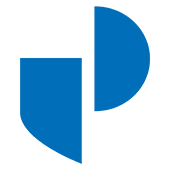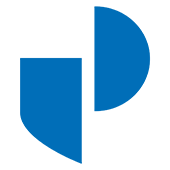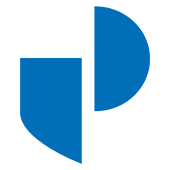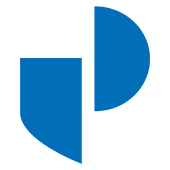En France, la sécurité au travail vient de franchir un tournant. Face à un niveau de mortalité professionnelle qui stagne, l’exécutif opte pour une stratégie plus offensive mêlant prévention, contrôles musclés et réponse pénale. Voici ce que les employeurs doivent anticiper.
En France, la sécurité au travail vient de franchir un tournant. Face à un niveau de mortalité professionnelle qui stagne, l’exécutif opte pour une stratégie plus offensive mêlant prévention, contrôles musclés et réponse pénale. Voici ce que les employeurs doivent anticiper.
Un palier mortel qui ne baisse plus
Chaque année, plus de 800 personnes perdent la vie dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce chiffre, communiqué par l’Assurance-maladie, s’est installé sur un plateau inquiétant. Derrière cette statistique se cache une réalité trop fréquente : après un accident, beaucoup d’entreprises ne réinterrogent pas leurs méthodes. L’Inspection du travail signale que, dans un dossier sur deux examiné à la suite d’un sinistre, l’évaluation des risques n’est ni actualisée ni suivie de mesures correctrices. Autrement dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets et la sinistralité se répète.
Ce statu quo a conduit le gouvernement à reconfigurer sa doctrine. Une circulaire interministérielle, signée fin juin par Astrid Panosyan-Bouvet et Gérald Darmanin, redessine l’action publique. Elle part d’un constat simple : la seule sensibilisation, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à infléchir durablement les comportements lorsque la pression concurrentielle, le manque de temps ou la sous-traitance diluent les responsabilités quotidiennes.
De la pédagogie à la contrainte : une nouvelle doctrine
Le texte assume un virage : la prévention restera le cap, mais elle doit désormais être “tirée” par la perspective de la sanction. Concrètement, les inspecteurs du travail voient leur champ d’intervention s’élargir. Ils peuvent déclencher des suites administratives et pénales pour des manquements graves, même sans accident avéré. En parallèle, la transaction pénale est encouragée, y compris pour des infractions réputées mineures, afin de corriger vite et de façon proportionnée les défaillances de terrain.
Cette logique n’abolit pas l’accompagnement ; elle le conditionne. Les entreprises qui démontrent une volonté d’agir — diagnostic réactualisé, plan d’actions chiffré, traçabilité des formations — auront un levier pour négocier et sécuriser leur mise en conformité. À l’inverse, l’inertie exposera à des procédures plus lourdes. Pour les directions, le message est clair : la prévention n’est plus un “plus”, c’est un impératif de gestion des risques juridiques et opérationnels.
Chaîne pénale renforcée et responsabilités élargies
Jusqu’à présent, une part significative des procès-verbaux transmis par l’Inspection du travail n’aboutissait à aucune suite. La circulaire réclame une coordination renforcée entre inspection et parquets : cosaisines plus fréquentes, priorisation des dossiers, information des victimes et meilleure articulation des enquêtes. Autre inflexion majeure : la recherche des responsabilités ne se limite plus à l’employeur direct. Les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre peuvent être concernés lorsque leur rôle a contribué au manquement.
Sur le plan des peines, l’arsenal existe déjà : les personnes morales encourent des amendes pouvant dépasser 300 000 € dans les dossiers d’homicide involontaire. Pourtant, en 2023, moins d’une centaine de condamnations ont frappé des entreprises pour ce motif ; l’effet dissuasif en sort affaibli, surtout pour les grands groupes. Le gouvernement agit à droit constant — un choix pragmatique dans un contexte politique mouvant — mais l’horizon pourrait bouger : une initiative législative annoncée pour l’automne évoque des amendes proportionnées au chiffre d’affaires, un accès aux marchés publics conditionné à des pratiques exemplaires, et la création d’un parquet spécialisé.
Ce que les entreprises doivent faire dès maintenant
Le nouveau cadre impose un passage à l’action méthodique. Au-delà de l’obligation générale de sécurité, il s’agit d’installer une gouvernance du risque visible, auditée et traçable.
- Réviser immédiatement l’évaluation des risques après tout incident, quasi-accident ou signal faible, et mettre à jour le document unique avec des mesures datées et financées.
- Prouver la traçabilité : feuilles d’émargement de formation, attestations d’habilitation, contrôles périodiques consignés, preuves de maintenance et d’achats d’EPI.
- Agir sur la sous-traitance : clauses contractuelles de sécurité, plan de prévention partagé, audits de terrain, réunions de coordination documentées.
- Outiller les managers de proximité : check-lists quotidiennes, droit d’alerte facilité, remontée des presque-accidents et retour d’expérience formalisé.
- Préparer un “kit contrôle” pour l’Inspection : organigramme sécurité, DUERP à jour, plan d’actions, preuves de diffusion des consignes, indicateurs de suivi.
- Anticiper la voie pénale : cartographier les risques juridiques, définir une stratégie de transaction le cas échéant, et désigner un référent interne.
- Mesurer l’impact financier : budgéter la prévention en intégrant le risque d’amende et les coûts indirects (arrêts, image, non-qualité).
Ce virage n’est pas qu’un durcissement punitif : c’est une invitation à professionnaliser la prévention, à la hisser au rang d’enjeu business. Les directions qui s’en saisissent transformeront un risque légal en avantage opérationnel : moins d’accidents, moins d’aléas, plus de performance.
Auteur : Inforisque.Sur le même sujet :