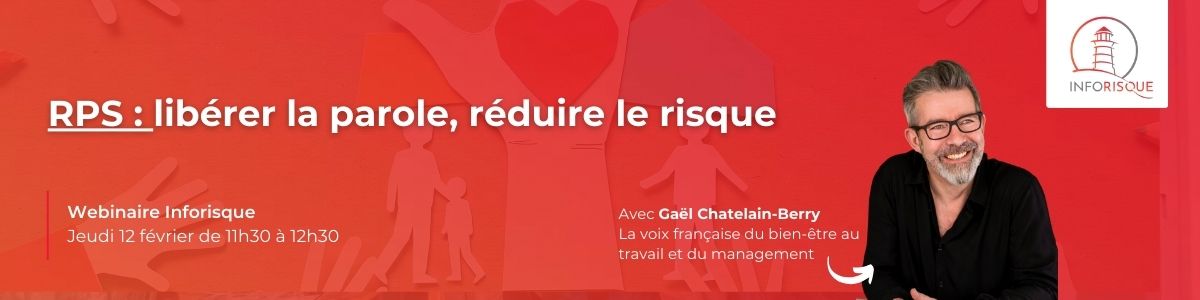Le secteur de la pêche est souvent analysé sous l’angle économique, mais un nouveau rapport apporte un éclairage inédit : l’impact carbone de cette activité pourrait avoir des répercussions majeures sur les conditions de travail et la sécurité en mer. Cette étude offre un point de vue précieux pour comprendre les risques émergents.
Le secteur de la pêche est souvent analysé sous l’angle économique, mais un nouveau rapport apporte un éclairage inédit : l’impact carbone de cette activité pourrait avoir des répercussions majeures sur les conditions de travail et la sécurité en mer. Cette étude offre un point de vue précieux pour comprendre les risques émergents.
Un diagnostic environnemental qui interroge la sécurité au travail
Pour la première fois, une analyse complète du bilan carbone de la flotte française a été réalisée afin de mesurer l’empreinte environnementale de cette activité. L’exercice, mené via une méthodologie rigoureuse appliquée habituellement à d’autres secteurs industriels, prend en compte l’ensemble de la phase productive : construction des navires, consommation de carburant, utilisation des engins, maintenance et fin de vie.
Les données compilées révèlent un niveau d’émissions atteignant 1,1 million de tonnes de CO₂ par an. Si ce chiffre ne représente qu’une faible part de l’empreinte nationale, il expose toutefois un paradoxe préoccupant : la dépendance massive aux carburants fossiles place les marins dans une situation de vulnérabilité, tant économique que sécuritaire.
En effet, les variations du prix du carburant, les transformations réglementaires futures ou encore les exigences environnementales croissantes pourraient accentuer la pression sur les équipages. Lorsqu’un secteur devient énergétiquement sensible, ce sont souvent les conditions de travail qui se retrouvent fragilisées, notamment via l’intensification de l’effort, la prolongation des sorties en mer ou l’utilisation d’équipements usés faute de moyens pour les remplacer.
Techniques de pêche : des écarts d’impact qui reflètent des risques humains
L’étude révèle d'importantes disparités selon les engins utilisés. Les chalutiers de fond se distinguent par une consommation énergétique extrêmement élevée, imputable à la puissance nécessaire pour tracter les filets sur les fonds marins. Ce type de pêche représente près de la moitié des émissions totales, pour une part modérée des volumes débarqués.
Au-delà de l’impact carbone, ces pratiques posent un enjeu majeur de sécurité au travail. Une demande énergétique importante signifie des moteurs plus sollicités, une maintenance plus complexe et une exposition accrue aux risques mécaniques.
À l’inverse, les navires utilisant des techniques dites « dormantes » – casiers, lignes ou filets – présentent une empreinte carbone moins élevée. Même si ces méthodes restent physiquement exigeantes, leur meilleure performance énergétique peut offrir un cadre plus stable pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’analyse par taille de navire apporte un autre enseignement crucial : les plus grands navires, bien qu’ils ne représentent qu’une fraction de la flotte, génèrent une part disproportionnée des émissions. Cette disproportion entraîne une utilisation intensive de carburant et accroît les risques liés aux opérations lourdes, aux moteurs puissants et aux longues campagnes de pêche.
Un risque encore sous-estimé : la déstabilisation des sols marins
L’évaluation a intégré une dimension rarement prise en compte : l’impact du chalutage de fond sur les sédiments marins. En remuant les sols, les filets remettent en suspension du carbone stocké, ce qui accentue le bilan carbone global. Selon les estimations, cette perturbation pourrait représenter entre 8 % et 44 % des émissions totales du secteur.
Si cet impact est avant tout environnemental, il n’est pas sans conséquences pour les équipages. La pression croissante pour limiter ce type de pêche pourrait entraîner des restructurations, des fermetures temporaires ou des reconversions forcées. Dans ces contextes de transition, les risques professionnels augmentent : matériel obsolète non remplacé, intensification des sorties pour maintenir les revenus, fatigue accumulée, désorganisation interne.
Pour avancer, les acteurs du secteur devront disposer d’outils d’évaluation fiables. Le rapport prévoit d’ailleurs de rendre publiques les bases de données et feuilles de calcul utilisées, afin d’aider les décideurs à planifier une transformation du secteur cohérente, durable et protectrice pour les travailleurs.
Téléchargez le rapport : Bilan des émissions carbone de la pêche française.
Auteur : Inforisque.Sur le même sujet : Une étude inédite lève le voile sur l'empreinte carbone de la pêche.