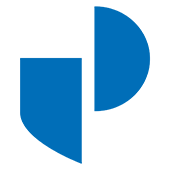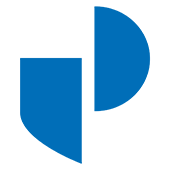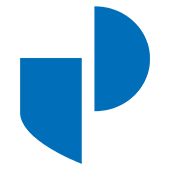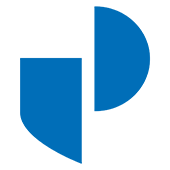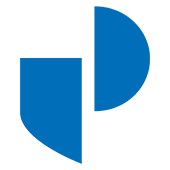Le changement climatique n’augmente pas seulement la fréquence des tempêtes et des canicules : il bouleverse aussi, en profondeur, la sécurité au travail. Agents biologiques plus présents, substances chimiques plus instables, exposition prolongée des salariés… Voici comment anticiper ces menaces et adapter votre prévention.
Le changement climatique n’augmente pas seulement la fréquence des tempêtes et des canicules : il bouleverse aussi, en profondeur, la sécurité au travail. Agents biologiques plus présents, substances chimiques plus instables, exposition prolongée des salariés… Voici comment anticiper ces menaces et adapter votre prévention.
Des menaces biologiques qui s’étendent et se déplacent
À mesure que les températures grimpent, des agents pathogènes ou allergènes s’installent dans de nouvelles zones géographiques ou étirent leurs périodes d’activité. Les métiers au contact du vivant — espaces verts, assainissement, agroalimentaire, soin, élevage — voient leur environnement de travail évoluer plus vite que leurs protocoles.
Le moustique tigre en est l’illustration emblématique. Introduit depuis le début des années 2000, il occupait, au début de 2025, 81 départements français. Fin mai 2025, les autorités ont signalé deux premiers cas de transmission locale de maladies qu’il peut véhiculer (dengue, Zika, chikungunya) chez des personnes n’ayant pas voyagé hors de la métropole. Pour les employeurs, cela signifie un risque accru de contamination pour les personnels en extérieur et une vigilance à renforcer lors des interventions à domicile.
Au-delà des vecteurs, la saison des pollens s’allonge et la croissance des moisissures s’emballe dans les locaux humides lors des épisodes de chaleur. Dans les ateliers et entrepôts agroalimentaires, par exemple, la montée des températures favorise les micro-organismes allergènes sur les zones de stockage insuffisamment ventilées, allongeant la période d’exposition des opérateurs.
Chaleur et chimie : quand les produits deviennent imprévisibles
La stabilité de nombreuses substances chimiques dépend fortement de la température et de l’hygrométrie. Avec la chaleur, certains solvants s’évaporent plus vite, d’autres se dissolvent davantage dans l’eau et plusieurs deviennent plus facilement inflammables ou explosifs. Résultat : des émissions plus importantes dans l’air, des transferts vers les réseaux d’eaux plus fréquents et des réactions dangereuses difficilement maîtrisables.
Pour les salariés exposés, les conséquences peuvent être sévères :
- risque accru d’asthme et d’autres pathologies respiratoires ;
- intoxications aiguës ou chroniques ;
- cancers liés à certaines expositions ;
- effets reprotoxiques et troubles du développement ;
- atteintes neurologiques en cas d’expositions répétées.
Un accident marquant rappelle la chaîne causale : en mai 2020, une fuite de gaz toxique dans une usine de polymères en Inde a provoqué des décès et de nombreuses hospitalisations. L’analyse a retenu une défaillance technique initiale, mais la sévérité de l’événement a été amplifiée par des températures extrêmes ayant favorisé la vaporisation du gaz. La leçon pour l’industrie est claire : un écart climatique peut transformer un incident maîtrisable en crise majeure.
Agir sur le risque biologique : organisation, veille et équipements
Dans un contexte mouvant, les mesures de prévention ne peuvent rester figées. L’employeur doit s’appuyer sur une veille sanitaire (épidémiologie, entomologie, alertes régionales) et traduire ces signaux en décisions opérationnelles. Plusieurs leviers rapides existent :
- Adapter l’organisation du travail : horaires décalés, limitation des interventions aux périodes les moins à risque, planification des tâches en fonction des pics d’activité des vecteurs.
- Former et informer : reconnaître les symptômes, savoir déclarer une exposition, maîtriser les bons gestes (protection cutanée, inspection des zones d’eau stagnante, conduite à tenir en cas de piqûre).
- Renforcer les protections : mise à disposition d’équipements adaptés (gants, masques, bottes, vêtements couvrants, filtres anti-moisissures), vérification de leur conformité et de leur disponibilité réelle.
- Assainir les locaux : contrôle de l’humidité, ventilation efficace, nettoyage renforcé des zones sensibles et gestion des déchets biologiques.
Maîtriser le risque chimique : recensement, stockage et DUERP
La première étape consiste à cartographier toutes les substances dangereuses utilisées sur site et à vérifier leur comportement en conditions climatiques dégradées. Les fiches de données de sécurité sont votre boussole : elles guident l’analyse des seuils de température, d’hygrométrie et de ventilation nécessaires.
Traduisez ensuite ces informations en exigences de terrain :
- adapter les zones de stockage (isolation thermique, contrôle du taux d’humidité, dispositifs anti-débordement) ;
- réviser les procédures de transfert et de mélange en période de chaleur ;
- mettre à niveau la détection et l’extraction des vapeurs ;
- prévoir des plans d’urgence spécifiques canicule (arrêts sécurisés, consignations, équipes réduites et entraînées).
Dans tous les cas, la pierre angulaire reste le document unique d’évaluation des risques professionnels : il doit être actualisé pour intégrer les scénarios liés au climat (épisodes de chaleur, vents violents, pluies intenses) et leurs effets sur les expositions biologiques et chimiques. Sans cette mise à jour, formations, EPI et choix techniques risquent d’être inadaptés aux réalités de demain… qui sont déjà celles d’aujourd’hui.
Auteur : Inforisque.Sur le même sujet : Changement climatique : risque biologique et risque chimique.