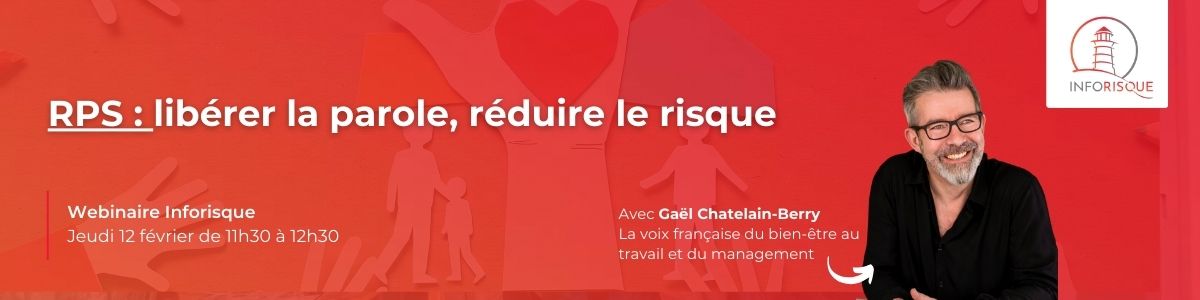"Une lampe à incandescence, cela représente 80 à 100 lumen par watt. Une LED, 120 à 150 : en termes de rendement et d’économie d’énergie, il n’y a pas de doute… Nous passerons au tout-LED", assure Samuel Morin. Contrôleur sécurité pour la Carsat de Bretagne, il est venu raconter lors d’un colloque de l’INRS qui se tenait cette semaine à Paris comment il aide les entreprises de sa région à prévenir le risque lié aux rayonnements optiques artificiels : lumière bleue des LED, infrarouges, ultra-violets, etc.. Depuis que l’Anses a émis, en 2011, un avis appelant à la vigilance sur ce type d’éclairage, les risques aigus liés à l’exposition sont bien connus (voir notre article). Praticienne au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Marine Fontaine, invitée du colloque elle aussi interpelle. Mais pas tant sur les risques aigus que sur les effets de l'exposition à long terme
Exposition au long terme et DMLA
Car selon elle, l’exposition "insidieuse, chronique, et cumulée" aux rayonnements optiques artificiels (notamment la lumière bleue) serait l’un des facteurs d’apparition de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). On est ici loin des recherches menées par l’Inserm et qui estiment que diffuser de la lumière bleue artificielle dans certains locaux de travail peut compenser les dérèglements de l’horloge interne des salariés (voir notre article). En tout état de cause, la vigilance en entreprise n'est pas chose aisée, qu'il s'agisse d'effets à long ou à court terme. Car les sources d’émissions sont innombrables. "Tous les secteurs sont touchés, l’industrie comme le tertiaire", précise Samuel Morin. En revanche, "toutes les sources ne sont pas dangereuses", poursuit-il. "Mais il faut connaître leurs caractéristiques, pour pouvoir évaluer les risques".
Passer en revue les sources d’émission
Les rayonnements artificiels émanent aussi bien des lampes germicides utilisées dans l’agroalimentaire ou pour le traitement de l’air, que dans les lampes UVA utilisées dans le domaine de la qualité afin de faire apparaître les défauts. Pour polymériser les colles, l’industrie recourt aussi aux lampes à UV, tandis que certaines lampes de séchage émettent des infrarouges. Ce à quoi s’ajoutent les rayonnements, plus faibles certes, émis par les écrans d’ordinateurs, par les photocopieurs, etc. Il faut par ailleurs prendre en compte certains procédés industriels comme le soudage à l’arc, rappelle le Samuel Morin, et quelques procédés de découpage du plastique. Sans oublier les produits eux-mêmes émissifs. L’INRS a listé dans un de ses supports de documentation (ED 6113) les sources de rayonnement optiques dangereuses et non-dangereuses.
S’appuyer sur la directive et l’INRS
De là, l’employeur peut prendre appui sur la directive européenne sur la prévention des travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels (2006/25/CE), retranscrite depuis 2010 dans le droit français (voir notre article). Elle fixe les VLEP (valeurs limite d’exposition professionnelle), cadre l’évaluation des risques, l’information, la formation et la surveillance médicale des salariés exposés. Elle propose aussi mesures et moyens de prévention. Mais elle est "difficile à mettre en oeuvre", objecte Samuel Morin. "Il existe ceci dit des moyens pour évaluer les risques" dans les locaux de travail, assez simplement. Faire appel à l’appui technique de l’INRS par exemple, qui peut se déplacer pour procéder à des caractérisations in situ. C’est ce qu’on fait deux entreprises, dont se souvient Samuel Morin.
Risque de dépassement des VLEP
 "La première fabriquait des profilés en alu, la seconde des tuiles de carrelage", raconte le préventeur. "Le but était de faire la liste exhaustives des sources émettrices et de savoir, pour chacune, s’il y avait un risque ou non de dépassement des VLEP". Plusieurs sources de rayonnement posent alors question : le séchoir à gaz, les lampes à vapeur de mercure, le séchoir à lampes infrarouges et les postes à souder. Dans les deux premiers cas, il s’avère finalement que les salariés ne sont pas directement exposés visuellement aux sources d’émission de rayonnements UV. Pour le séchoir à infrarouges, on ajoute une fonctionnalité afin de stopper le fonctionnement des lampes si un technicien de maintenance en venait à ouvrir le capot du séchoir. "On sait que le risque est avéré dans le cas d’une exposition importante", justifie Samuel Morin. Quant aux postes à souder, des éléments de protection collective qui "n’existaient pas" sont installés. Sans ces protections supplémentaires, le risque de dépassement des VLEP était "avéré au-delà de 5 minutes d’exposition", selon Samuel Morin.
"La première fabriquait des profilés en alu, la seconde des tuiles de carrelage", raconte le préventeur. "Le but était de faire la liste exhaustives des sources émettrices et de savoir, pour chacune, s’il y avait un risque ou non de dépassement des VLEP". Plusieurs sources de rayonnement posent alors question : le séchoir à gaz, les lampes à vapeur de mercure, le séchoir à lampes infrarouges et les postes à souder. Dans les deux premiers cas, il s’avère finalement que les salariés ne sont pas directement exposés visuellement aux sources d’émission de rayonnements UV. Pour le séchoir à infrarouges, on ajoute une fonctionnalité afin de stopper le fonctionnement des lampes si un technicien de maintenance en venait à ouvrir le capot du séchoir. "On sait que le risque est avéré dans le cas d’une exposition importante", justifie Samuel Morin. Quant aux postes à souder, des éléments de protection collective qui "n’existaient pas" sont installés. Sans ces protections supplémentaires, le risque de dépassement des VLEP était "avéré au-delà de 5 minutes d’exposition", selon Samuel Morin.
Un logiciel et des données de luminance
Ce calcul, le préventeur l’a réalisé avec le logiciel Catrayon. Mis au point par l’INRS il y a déjà quelques années (voir notre brève), il concentre une base de données des sources d’émission déjà caractérisées en laboratoire. L’employeur qui souhaite vérifier s’il y a au sein de ses locaux un dépassement des VLEP sur les rayonnements optiques peut ainsi prendre pour référence ce qu’il y a dans la base de données pour, par exemple, un poste à souder. Le logiciel permet aussi, depuis peu, de prendre en compte les mesures et les sources indiquées par l’utilisateur. Certaines sources d’émissions, comme les LED, sont par ailleurs mieux documentées aujourd’hui : "De plus en plus", constate le Samuel Morin, "on voit apparaître sur les emballages des données de luminance, c’est à dire des données de risques d’éblouissement". De quoi éclairer quelques employeurs.
Sur le même sujet : Pleins feux sur les Rayonnements.
Auteur : Par Claire Branchereau, actuEL-HSE.
Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.