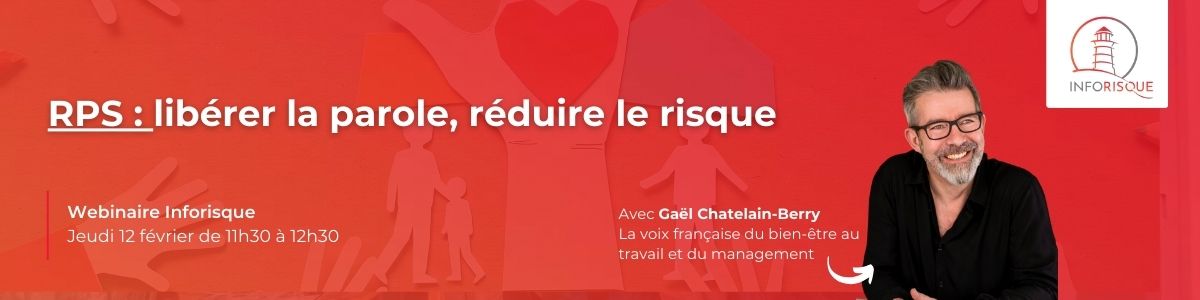Selon les statistiques de la CnamTS, 150 accidents dus à une explosion et engendrant un arrêt de travail ont lieu chaque année en France (en moyenne sur les 10 dernières années). La gravité de ces accidents est souvent supérieure à celle d'autres accidents du travail. En matière de prévention, la priorité est toujours d'empêcher la formation du phénomène. Et s'il survient néanmoins, d'en atténuer les effets.
 En 2001, la catastrophe d'AZF faisait 31 morts et 2 500 blessés. Quelques années plus tôt, le bilan de l'explosion d'un silo de céréales à Blaye était de 11 morts et un blessé. En Europe, il y aurait une explosion par jour sur le lieu de travail. Ces événements peuvent avoir différentes origines : incompatibilités de produits chimiques, formation d'atmosphères explosives (Atex)... S'ils ne sont pas tous aussi dramatiques pour la vie ou la santé des salariés, ils ont souvent pour conséquence d'endommager ou détruire l'outil de production. L'entreprise ne s'en relève pas toujours et ses salariés peuvent perdre leur emploi.
En 2001, la catastrophe d'AZF faisait 31 morts et 2 500 blessés. Quelques années plus tôt, le bilan de l'explosion d'un silo de céréales à Blaye était de 11 morts et un blessé. En Europe, il y aurait une explosion par jour sur le lieu de travail. Ces événements peuvent avoir différentes origines : incompatibilités de produits chimiques, formation d'atmosphères explosives (Atex)... S'ils ne sont pas tous aussi dramatiques pour la vie ou la santé des salariés, ils ont souvent pour conséquence d'endommager ou détruire l'outil de production. L'entreprise ne s'en relève pas toujours et ses salariés peuvent perdre leur emploi.
La démarche Atex
Une explosion est une réaction de combustion très rapide qui entraîne une élévation de température et de pression. Elle n'a lieu que lorsque certaines conditions sont réunies après formation d'une atmosphère explosive, qui résulte d'un mélange avec l'air de substances combustibles (liquides, gaz ou poussières) dans des proportions telles qu'une source d'inflammation d'énergie suffisante produise son explosion. Le Code du travail (articles R.4227-42 à R.4227-54) impose à l'employeur d'organiser la prévention des explosions sur le lieu de travail. Il doit notamment évaluer le risque d'explosion et formaliser cette analyse au travers du Document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE), annexé au document unique. Ce travail est intégré à celui plus global d'évaluation des risques. Il passe par la réalisation d'un inventaire des produits combustibles, l'analyse des procédés qui les mettent en oeuvre et des installations présentes sur le site (réacteur, cuve, silo, broyeur, circuit de dépoussiérage...), la réalisation du zonage Atex (qui consiste à délimiter et hiérarchiser les zones où peuvent se former des atmosphères explosives) ou encore l'identification des sources potentielles d'inflammation. Si l'employeur peut s'appuyer sur des compétences externes, son implication dans la démarche est essentielle pour se l'approprier et mettre à jour les informations. Elle lui permet de conserver un regard critique sur ce qu'un prestataire pourrait lui proposer.
Prévention en trois temps
À la suite de l'évaluation des risques, la démarche de prévention s'articule en trois temps : empêcher la formation d'une Atmosphère explosive, éviter son inflammation et, au cas où l'explosion surviendrait quand même, en atténuer les effets. Elle doit être menée en cohérence avec la démarche de prévention du risque chimique de manière générale. Travailler sur la prévention des explosions en captant les vapeurs et les poussières va dans le même sens que prévenir les risques toxicologiques pour les personnes. Cela implique d'agir sur les produits (choix, concentrations, mise en oeuvre, présence de comburant...), les sources d'inflammation possibles (matériels, travaux par points chauds, étincelles...), ou l'organisation du travail (signalétique, formation des salariés, encadrement des interventions d'entreprises externes...). Enfin, des mesures doivent permettre d'atténuer les effets néfastes d'une explosion au cas où celle-ci ne pourrait être évitée (évents d'explosion, systèmes de découplage technique ou d'isolement, extincteurs déclenchés...). Rappelons également que dès la conception des locaux et des installations, certains choix sont déterminants. Ceux concernant les matériaux utilisés par exemple, ou l'éloignement des installations dangereuses vis-à-vis du risque d'explosion de toutes les autres constructions et des travailleurs...
6 conditions simultanées pour la survenue d'une explosion :
- la présence d'un comburant (l'oxygène de l'air en général) ;
- la présence de produits combustibles ;
- la présence d'une source d'inflammation ;
- le combustible doit être en suspension (gaz/vapeurs, aérosols ou poussières) ;
- l'obtention d'un domaine d'explosivité (domaine de concentrations dans l'air du combustible à l'intérieur duquel les explosions sont possibles) ;
- un confinement suffisant (en son absence, on a une combustion rapide avec des flammes mais sans effet de pression notable si l'Atex est de volume limité).
Zonage et matériel Atex
 L'identification des zones (bâtiment, local, poste de travail) où peuvent se former des atmosphères explosives est à la charge de l'employeur. Les locaux ou emplacements concernés doivent être signalés à l'aide du pictogramme réglementaire.
L'identification des zones (bâtiment, local, poste de travail) où peuvent se former des atmosphères explosives est à la charge de l'employeur. Les locaux ou emplacements concernés doivent être signalés à l'aide du pictogramme réglementaire.
Tous les matériels, électriques et non-électriques, présents dans les zones à risques d'explosion, ainsi que les systèmes de protection contre les explosions, doivent être conformes aux prescriptions techniques liées aux types de zone. Attention, l'entretien ou la réparation du matériel ne doit en aucun cas entraîner une dégradation du niveau de sécurité initial. Des référentiels de certification volontaire ont été établis par l'Ineris pour les réparateurs de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et les entreprises extérieures intervenant dans la conception, la réalisation et/ou la maintenance des installations électriques en atmosphères explosives.
Pour aller plus loin :
- Dossier Travail & Sécurité : Explosion sur le lieu de travail
- Dossier INRS : Explosion sur le lieu de travail, ce qu'il faut retenir
- Publication : Explosion et lieu de travail - Le point des connaissances sur...
- Publication : Mise en oeuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives (ATEX)
- Guide méthodologique