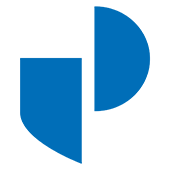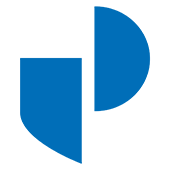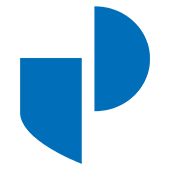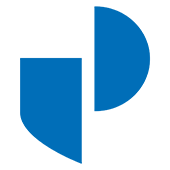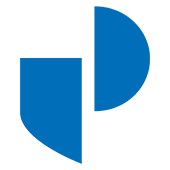Porter un patient n’est pas un geste anodin : c’est un facteur majeur de TMS et d’accidents pour les soignants. La démarche ALM propose une autre voie, fondée sur l’autonomie des personnes aidées et l’usage raisonné d’aides techniques. Voici comment l’appliquer.
Porter un patient n’est pas un geste anodin : c’est un facteur majeur de TMS et d’accidents pour les soignants. La démarche ALM propose une autre voie, fondée sur l’autonomie des personnes aidées et l’usage raisonné d’aides techniques. Voici comment l’appliquer.
Pourquoi bannir le portage en santé ?
Dans les services de soins et d’aide à domicile, les équipes soulèvent, retiennent, tirent ou poussent des personnes fragilisées pour les aider à se lever, se tourner, s’asseoir, marcher ou accéder à la toilette. Ces manutentions, répétées à longueur de journée, sont au cœur des troubles musculosquelettiques, des accidents du travail et, trop souvent, d’inaptitudes professionnelles. Or chaque « déplacement » est une succession d’actions élémentaires : créer des appuis, transférer le poids, pivoter, stabiliser. Il suffit qu’un maillon manque — une douleur au coude, une faiblesse des membres inférieurs — pour que l’ensemble se grippe. Continuer à « faire à la place de » entretient la dépendance de la personne aidée et accroît la charge physique du professionnel. D’où l’intérêt d’une méthode qui restaure l’autonomie dès que possible et limite les efforts risqués.
ALM : évaluer, guider et seulement compenser
L’« Accompagnement de la Mobilité » (ALM) change de paradigme : on ne porte plus, on accompagne un mouvement en s’appuyant d’abord sur les capacités restantes de la personne. Le professionnel observe et teste ce que la personne peut réaliser seule à chaque étape (par exemple, maintenir la jambe droite puis la gauche tendue six secondes pour estimer l’équilibre avant une station debout). Ensuite, il donne des consignes claires, encourage le patient à enchaîner les micro-mouvements nécessaires, puis n’intervient physiquement que pour compenser ce qui est réellement impossible.
Cette évaluation est située et évolutive : après une chirurgie, les capacités peuvent progresser en quelques jours ; chez une personne âgée, elles fluctuent au cours d’une même journée. L’ALM demande donc d’ajuster le scénario de déplacement à chaque fois, sans recette universelle.
- Observer l’environnement, sécuriser l’espace et préparer le matériel.
- Évaluer les capacités résiduelles pour chaque étape (appuis, poussées, tirages).
- Donner une consigne verbale et gestuelle, laisser la personne initier le mouvement.
- Apporter une assistance minimale, puis utiliser une aide technique ciblée si nécessaire.
- Réévaluer immédiatement après le déplacement pour adapter la suite.
Ce cadre dépasse les anciens modules « gestes et postures » hérités de la manutention de charges inertes : il s’agit d’un soin qui vise l’autonomie, tout en réduisant l’effort physique du soignant.
Outils d’aide : choisir l’utile, éviter le risqué
Les aides techniques ne doivent pas remplacer ce que la personne peut encore faire, mais pallier uniquement les capacités abolies. Bien choisis et correctement utilisés, elles fluidifient le déplacement, réduisent les contraintes sur le rachis et sécurisent la manœuvre.
- Draps ou plaques de glisse pour repositionner sans friction.
- Poignées de traction ou barres de redressement pour favoriser l’auto-propulsion.
- Lève-personnes (rails ou mobiles) pour transferts impossibles sans portage.
- Verticalisateurs pour passages assis-debout lorsque l’extension des membres est limitée.
- Matelas ou coussins à air pour réduire l’effort lors des translations.
Vigilance toutefois : un dispositif mal adapté au patient, à l’instant ou à la configuration du lieu peut gêner le mouvement, accroître les contraintes sur le dos du soignant ou créer un risque de chute. Un tri (« au bon patient, au bon moment ») et une évaluation sur site sont indispensables avant intégration à l’organisation de soins.
Former les équipes et embarquer les directions
La diffusion de l’ALM passe par la formation initiale et continue, mais aussi par une stratégie d’entreprise. Des acteurs du secteur sanitaire et médico-social ont internalisé des compétences pour accélérer le déploiement et capitaliser sur les retours d’expérience. Exemple parlant : un réseau d’établissements a bâti une équipe de formateurs internes à partir de 2021, formant 790 professionnels en 2022, 993 en 2023 et 1 060 en 2024. Résultat observé : dix points de turnover en moins chez les salariés formés par rapport au reste de l’organisation. Au-delà des chiffres, l’adhésion naît souvent sur le terrain, quand les équipes constatent la diminution des douleurs, la qualité accrue des soins et le gain d’autonomie des résidents.
Pour ancrer les pratiques, des recyclages sont planifiés : en règle générale, tous les deux ans pour les acteurs et tous les trois ans pour les formateurs. Entre ces échéances, des rappels fréquents évitent le retour réflexe au portage en cas d’urgence, d’absence d’un matériel ou de situation inédite. Les ateliers immersifs — où cadres et dirigeants testent eux-mêmes les scénarios côté soignant et côté patient — facilitent l’investissement dans les équipements et la libération du temps nécessaire à la formation. Le retour sur investissement s’illustre par la baisse des arrêts, la prévention des inaptitudes et la fidélisation des équipes.
Dans une approche sécurité au travail, trois leviers se renforcent mutuellement : montée en compétences des professionnels, standardisation d’un langage commun (évaluer, guider, compenser), et disponibilité d’aides techniques adaptées. Ajoutez un pilotage par les résultats (TMS, accidents, absentéisme, turnover) et l’ALM devient un véritable projet d’entreprise, orienté performance sociale et qualité des soins.
Auteur : Inforisque.Source : « Accompagner la mobilité » : la démarche ALM. Mieux soigner sans porter.